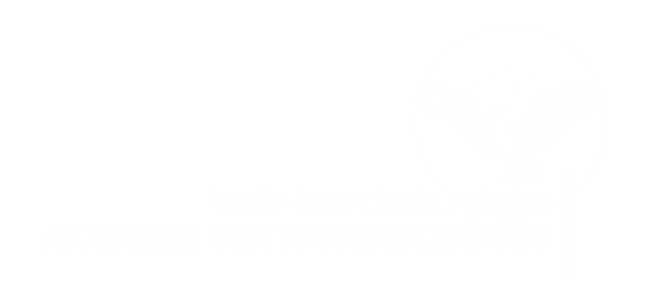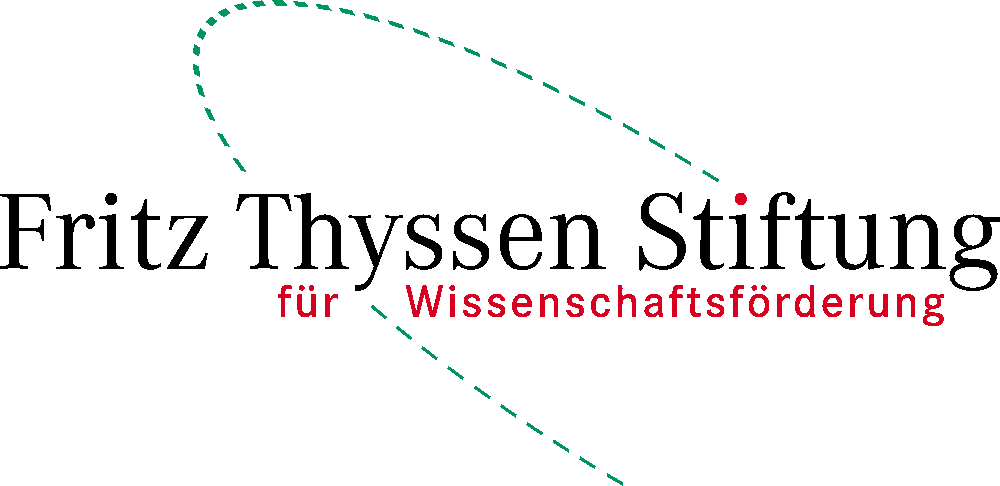Jean-Louis Burnouf an Wilhelm von Humboldt, 31.03.1825 (Konzept)
|74r| Mr le Bon,Je me reproche beaucoup de n’avoir pas répondu plustôt à la lettre dont vous avez bien voulu m’honorer en date du 29 Dbre der. Ce retard vient moins de négligence que d’occupations qui me maîtrisent et que je ne puis remettre. Vous êtes infiniment trop bon, Monsieur, d’avoir fait quelque attention à l’article de Philologie grecque-sanskr.[a] dt[b] j’ai eu l’honr de vous faire hommage. Toutes les idées qui s’y trouvent beaucoup trop succinctemt d indiquées, vous sont bien plus familières qu’à moi, et ce m’est un grand honr que vous preniez la peine d’en rectifier qques unes. Ainsi, par ex. j’ai peut-être trop fait entendre que je désirerais que, comme en grec, on rétablît les véritables désinences en séparant les mots. Ce n’est point là du tout ma prétention; je désirerais qu’on séparât autant qu’il est possible, mais en laissant subsister le changement de les[c], et je trouve très bien Bhagavad Gita, et non Bhagavat-gita et autres semblables. Votre opinion, quand elle ne serait pas jointe à celle de Mr Schlegel, suffirait ***** <seule> pour déterminer la mienne. Je pense <aureste> que quand la langue grecque a été écrite par tout le monde et qu’elle s’est répandue dans les pays étrangers, on a trouvé commode, pour en faciliter l’intelligence, de rétablir en écrivant les terminons[d] réelles. Quant à la prononciation il est très probable qu’elle demeure comme <qu’après cette revolon[e] dans la manière d’écrire elle> resta ce qu’elle était <auparavant>. Aujourd’hui encore les Grecs prononcent τὸμπόλεμογκαὶ τημμαχη &cet quoi qu’ils écrivent τὸν πόλεμον καὶ. Et même ils vont plus loin, car ils disent tombolemonguè &cet substituant le son du b et du ga français au π et au κ. Voilà certes des altérations tout à fait semblables à celles que les mots sanskrits se font subir l’un à l’autre. De même dans l’intérr[f] d’un mot, les grecs écrivent ἀγκαλιάζω, <γέροντες> et prononcent angaliazo, γέροντες et pronon g<u>érondes. J’en tire la conclusion que la prononciation est est, à **g dans beaucoup de cas, indépendante de l’orthographe. N’en avons nous pas mille exemples dans notre langue française, et beaucoup plus encore en anglais? Mais je n’en suis pas moins d’accord que p|our| une langue aussi peu vulgaire que le sanskrit, il est <sera> bon encore long-|74v|temps <(sinon toujours)> de conserver l’orthographe des MSS, que je regarde coe[g] la représentation graphique de la prononciation. Tandis <parole prise dans son ensemble, tandis> que l’orthographe du grec, celle du français, celle de l’anglais, sont <plutôt> la représentation des rapports <mots> considérés isolément et selon leurs rapports grammaticaux.
La considéron[h] que vous tirez de l’accent est parfait ingénieuse et frappante de justesse; il est
évident que tout assemblage de syllabes
ne forment
<qui ne portent porte>
qu’un accent,
n’est
<ne forme>
qu’un mot. Malheureusement nous n’avons aucune idée de l’accentuation
du sanskrit, et ce défaut nous fait sentir davantage combien nous soes[i] redevables aux grammairiens
alexandriens et autres
<anciens>
qui ont noté l’accent du grec. Réduits aux conjectures, ne pourrions
nous pas penser que tout mot vraiment composé, c. à
d.[j] tout mot
dont le dernier élément seul conserve une dé***** son inflexion grammaticale, n’a par cela même qu’un seul accent:
ainsi par ex. unmârgajalavâhîni (extra ripas aquam vehentia) ferait un seul mot et ne serait pas plus
divisible que ἀντιπαρεζάγω<, et καλοδιδάσκαλος>. La seule objection
naît de ces assemblages de radicaux bien plus nombreux que celui-ci, et qu’il
est difficile de concevoir qu’on puisse jamais prononcer uno tenore et avec un seul coup de voix. Mais, sauf cette objection
insoluble pour moi, la distinction me paraît
marquer
<manifeste>
entre les mots essentiellemt composés, et
ceux qui ne sont réunis que par des crases ou des permutations. Ainsi
Kṛipaṇâvand<h>âvanâthao (ambo miserabiles,
cæci, præsidio orbi) qui représente Kṛipanaoandhaoanâthao forment bien trois mots distincts qui ont reçu leurs
inflexions, lesquelles inflexions ont subi les changemts euphoniques voulus par les règles. Ces changements il faut
bien les conserver ne
détruisaient
<détruisent>
peut-être pas l’accent individuel de chaque mot. C’est une chose qu’on
ne peut |75r| affirmer; mais au moins est-il permis de le présumer. Il
est bien vrai qu’on dit en grec καλοκάγαθος
avec un seul accent et par une jonction de mots <apeuprès> du même
genre; mais ce mot n’est pas très long & le sanskrit en présente d’immenses.
Il ne suffit
<D’ailleurs καλός ayant perdu l’s du
nominatif, ce mot rentre ds[k] la classe des
vrais composés. Il ne suffit>
Mr, de vous avoir exposé mes doutes;
personne mieux que cous n’est en état de les lever. Restent des unions de mots
dont le vice m’est démontré; c’est par ex. p̔alamâpnoti
aulieu de
[l]. C’est une difficulté
purement gratuite, un inconvénient sans
avantage
<compensation>. Je sais qu’il tient à
l’absense d’un caractère pour
<l’usage de ne pas écrire>
l’a bref. Mais
cette absense
<cet usage>
même je
la
<le>
regarde comme une grave imperfection de
l’alphabet
<l’orthographe>
sanskrite. C’est à
elle
<lui>
que nous devons ces groupes innombrables qui rendent la lecture
difficile & l’impression plus difficile encore. L’arabe n’écrit aucune
voyelle; c’est une langue syllabique, d’un dégré
audessous des langues alphabétiques. Le sanskrit les
écrit toutes, excepté la plus commune qu’elle qu’il est aisé de
sousentendre; c’est une langue alphabétique, mais sous ce rapport, d’un dégré
audessous du grec. Ceci me ramène à votre observon[m] si
juste que le grec a sagement ôté ou ajouté au sanskrit ce que celui-ci avait de
trop ou de trop peu, soit p|our| les formes soit pour la phrase. Je crois que ce
phénomène tient au principe qu’en s’éloignant de sa source une langue tend à se
simplifier, ou en d’autres termes, <qu’elle> analyse d’avantage la
pensée. Ainsi le grec
à
<a>
moins de cas et se sert d’avantage des préposons[n]
pour en tener lieu. En poussant un peu plus loin, on perd quelques
cas de plus, et l’on a le grec moderne; on les perd tous et l’on a le français
et l’italien. Le grec n’a pas élagué sa conjugon[o]
|75v| coe sa déclinaison. C’est que cette
langue, plus analytique que le sanskrit, s’est cependant assez anciennement
développée pour conserver beaucoup du caractère synthetique qu’elle tient de
celuici: La conjugon grecque a même de plus que le
Sanskrit une grande richesse d’infinitifs,
et de pl
<et>
plusieurs temps à l’impératif, avec un subjonctif qui me semble manquer
tout à fait au Sanskrit. Celuici en revanche a le conditionel, <au>quel
le grec supplée par l’adverbe ἂν, nouvel
indice d’analyse. Ou surplus Enfin des desinences paraissent mieux
fondues et mieux amalgamées avec le radical dans les verbes grecs,
particulièrt[p] dans les verbes en ω. Elles sont
aucontraire plus reconnaissables, et plus voisines
de l’état de simples affixes dans les verbes Sanskrits. Le grec est donc au plus
haut dégré de l’échelle, suivant les conclusions de votre
admirable mémoire sur l’influence des formes grammaticales. Je
disais tout à l’heure qu’en perdant des cas, il se rapprochait en cela des
langues modernes, ce qui le rabaisserait beaucoup. Mais remarquons qu’il en a
conservé suffisamment pour les besoins de la pensée, et qu’il fait des
prépositions un usage qui répand sur tout le discours une grande clarté. Le grec
paraît avoir subi une double influence: synthetiser les formes des verbes, ana et n’y rien laisser qui trouble la pensée;
analyser tout le reste de manière à mettre dans le
plus grand jour
<jour le plus clair>
les rapports soit des mots soit des propositions. S’il y a quelque
chose de fondé dans ces reflexions, je le devrai, Mr, à la lecture de votre savant
parade, et l’idée
<mémoire. Je dois beaucoup aussi à celui>
que vous avez inséré dans la biblioth. ind. de
Mr
Schlegel. Pardonnez-moi si je suis entré dans de si longs
détails, et prenez veuillez vous en prendre à l’ardeur |76r|
que j’ai de m’instuire dans ces sortes de connaissances, auxquelles
malheureusement mes occupons[q] ne me permettent pas de me livrer
assez pour y profiter faire
<des>
progrès réels. Mon fils s’en
occupe un peu plus et vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu
donner à son article. il |sic| en a inséré depuis
plusieurs dans le journal asiatique qui peut-être vous
seront tombés sous la main. celui de Quelques phrases ont été
défigurées par l’imprimeur dans celui du 31e cahier
p. 92. Les fautes sont indiquées dans le suivant.[r] Il a besoin de toute l’indulgce des personnes qui, ce vous, Mr, aquant
approfondi la science, savent combien il doit nécessairt manquer aux essais d’un
je he[s].
Je vous prie <Je prends la liberté> , Mr le B. de vouloir bien accepter <vous envoyer adresser> un exemplre de la 13e édon de ma grre gque[t]. d’ C’est un hommage trop indigne de vous être offert; aussi est-ce un honr[u] que je sollicite pour l’ <cet> ouvrage et l’auteur en vous priant de vouloir bien l’accepter. Vous n’y trouverez point ces riches développts de vos Buttman[v] & de vos Matthiae[w]; j’ai été obligé de l’approprier aux bésoins de l’enseigt ds[x] notre pays; or nos élèves sont gens à qui les longs ouvrages font peur. Malgré l’exiguité de celui-ci, le public paraît y avr[y] trouvé qques détails neufs au moins en france. Mais c’est <ce sera toujours> peu de chose pour votre allemagne qui est la terre classique des études anciennes.
Agréez &ce.|76v; am Fuß der Seite, auf dem Kopf stehend:|
M. Wilh. Humboldt
repondu le 31 Mars 1825.
Fußnoten
- a |Editor| Gemeint sein könnte hier Burnoufs Artikel "Examen du système perfectionné de conjugaison grecque par M. Fr. Thiersch: ou indication de quelques rapports du grec avec le sanskrit suivi des analyse et extrait du Dévimahatmya; fragment du Markandéya Pourana", in: Journal Asiatique 3, 1823, S. 364–378; 4, 1824, S. 24–32.
- b |Editor| D.h.: "dont".
- c |Editor| D.h.: "lettres".
- d |Editor| D.h.: "terminaisons".
- e |Editor| D.h.: "revolution".
- f |Editor| D.h.: "intérieur".
- g |Editor| D.h.: "comme".
- h |Editor| D.h.: "considération".
- i |Editor| D.h.: "sommes".
- j |Editor| D.h.: "c’est à dire".
- k |Editor| D.h.: "dans".
- l |Editor| Schrift unklar, obwohl Burnouf sich auf Sanskrithandschriften bezieht – sicherlich mit Devanagari verwandt.
- m |Editor| D.h.: "observation".
- n |Editor| D.h.: "prépositions".
- o |Editor| D.h.: "conjugaison".
- p |Editor| D.h.: "particulièrement".
- q |Editor| D.h.: "occupations".
- r |Editor| Siehe die "Errata" auf S. 113 f. (Fußnote).
- s |Editor| D.h.: "jeune homme".
- t |Editor| D.h.: "grammaire grecque".
- u |Editor| D.h.: "honneur".
- v |Editor| D.h. Buttmanns Ausführliche griechische Sprachlehre von 1819. [FZ]
- w |Editor| D.h. Matthaes Ausführliche griechische Grammatik von 1807. [FZ]
- x |Editor| D.h.: "enseignement dans".
- y |Editor| D.h.: "avoir".