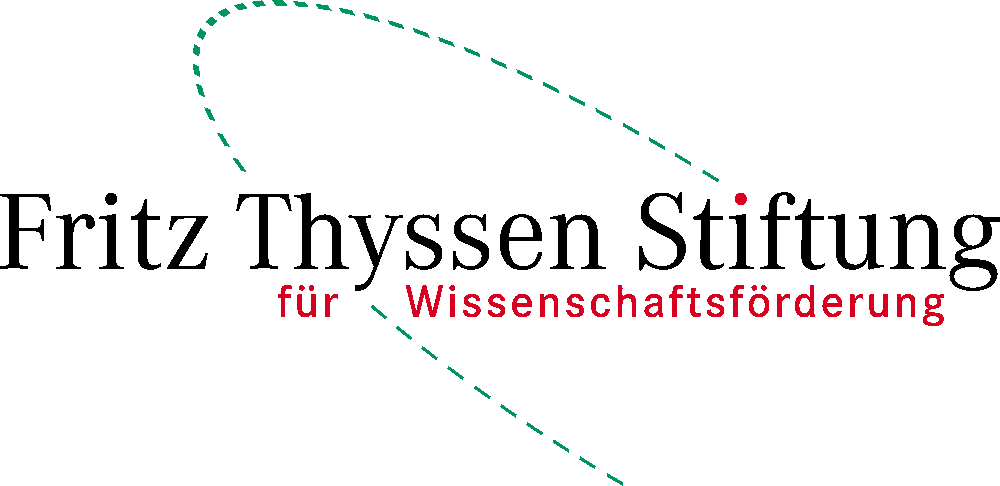Wilhelm von Humboldt an Eugène Vincent Stanislas Jacquet, 10.12.1831 ("Lettre à Mr. Jacquet")
Je commence, Monsieur, par vous envoyer une copie exacte des paragraphes où les PP. Gaspar de S. Augustin et Domingo Ezguerra, dans leurs grammaires tagala et bisaya, parlent des alphabets de ces langues. Vous verrez par-là que vous avez eu parfaitement raison de supposer que ces deux dialectes et l’ylog se servent du même alphabet; car quoique d’alphabet bisay offre quelques variétés plus considérables que les deux autres, l’identité n’en est pas moins évidente. Vous trouverez aussi, Monsieur, dans les deux alphabets que j’ai l’honneur de vous transmettre, le v de corazon de Totanes[a] et toutes les dix-sept lettres dont se compose l’alphabet des Philippines[1].
Vous attribuez l’expression de baybayin aux grammairiens espagnols, et cela m’a paru très-probable. Je vois cependant par le dictionnaire du P. Domingo de los Santos, que ces grammairiens ne reconnaissent pas ce mot pour le leur; il paraît appartenir aux indigènes, et l’étymologie qu’on en donne est assez curieuse. Baybayin est un substantif formé du verbe baybay (épeler, nommer une lettre après l’autre). Le même verbe signifie aussi, marcher sur la côte de la mer et naviguer près de la côte sans vouloir s’exposer aux dangers de la haute mer; c’est de cette métaphore que de los Santos dérive le mot, dans le sens d’épeler. J’ose aussi croire que la lettre b serait plutôt nommée ba que bay. De los Santos dit expressément que les indigènes nomment les consonnes ainsi: baba, caca, dara, gaga, &c.
Je suis entièrement d’accord avec vous, Monsieur, sur l’alphabet des Bugis. Les consonnes sont à-peu-près les mêmes que dans l’alphabet tagala; mais la manière d’écrire les voyelles en diffère beaucoup, non pas pour la forme seulement, mais pour le principe même de la méthode. C’est précisément ce point principal dont il est impossible de se former une idée juste d’après Raffles[b]. L’alphabet bugis manque de signes pour les voyelles initiales, à l’exception de l’a: mais le fait est que cet a, outre sa fonction de voyelle, est en même temps un fulcrum pour toutes les autres voyelles, un signe qui, de même que toute autre consonne, leur sert pour ainsi dire de corps. Vous aurez peut-être déja observé, Monsieur, en consultant la grammaire de Low, que la même chose a lieu dans le thaï. Dans la dernière série des consonnes thaï, se trouve un ā dont Low donne l’explication suivante[c]: ā, which is rather a vowel than a consonant, and is placed frequently in a word, as a sort of pivot, on which the vowel points are arranged. It forms, as it were, the body of each of the simple vowels. C’est ainsi qu’on place en javanais un h devant chaque voyelle initiale, mais sans le prononcer; et c’est encore ainsi que les mots malais commençant par īet ū sont précédés tantôt d’un l, tantôt d’un s.
M. Thomsen, missionnaire danois, a commencé à imprimer à Sincapore, en types fort élégans, un vocabulaire anglais-bugis, où l’écriture indigène est placée à côté de la transcription anglaise, par exemple: Earth, Tana ᨈᨊ. Le manque de fonds nécessaires a fait abandonner l’entreprise; mais je tiens de l’obligeance de M. Neumann la première feuille de ce vocabulaire, qu’il a rapportée de son intéressant voyage à Canton; l’analyse de deux cents mots, qu’elle renferme, m’a fourni ce que je viens de dire sur l’emploi de l’a bugis: noouvae (low water) y est écrit ᨊ ᨚ ᨕᨘ ᨓ ᨙ ᨕ; makounraï (femme), ᨆ ᨀᨘ ᨑ ᨕᨗ. Vous voyez par ces exemples, monsieur, que la difficulté que ces alphabets (qui considèrent les voyelles médiales comme de simples appendices de consonnes) éprouvent d’écrire deux voyelles de suite, est levée par le moyen de cet a. Le dévanagari, qui, parce que la langue sanscrite ne permet jamais à deux voyelles de se suivre immédiatement dans le même mot, a destiné les voyelles indépendantes à être exclusivement employées au commencement des mots, s’est mis par-là dans l’impossibilité d’écrire le mot bugis ouwae (eau). Je trouve dans un seul mot le redoublement d’une voyelle médiale, lelena ᨙ ᨙ ᨒ ᨊ: ce n’est là qu’une abréviation; on répète la voyelle, on néglige d’en faire autant pour la consonne, et le lecteur ne peut pas être induit en erreur; comme une consonne ne peut être accompagnée que d’une seule voyelle, il reconnaît de suite qu’il faut en reproduire le son.
Ce qui m’a frappé dans ce vocabulaire, c’est de trouver transcrit en anglais par o, le signe que Raffles rend par eng. Cet o, que je nommerai nasal, diffère à la vérité, dans l’impression anglaise, de l’autre qui répond à l’o bugis placé à la droite de la consonne, en ce que ce dernier est plus grèle et que l’autre est plus arrondi; mais cette différence typographique, très-peu sensible en elle-même, ne nous apprend rien sur la différence du son ou de l’emploi des deux signes bugis. Je crois m’être assuré que l’o noté au dessus de la consonne ( ᩶ ) a en effet un son nasal, tandis que le signe placé à la droite de la consonne ( ᨚ ) ne s’emploi que là où le son de l’o est pur et clair. C’est le mot sopoulo, dix, qui m’a mis sur la voie de cette distinction: il s’écrit ᨔ᩶ ᨄᨘ ᨒ ᨚ ; il renferme donc les deux o[2]. Or, sopoulo est le sanpóvo tagala (Totanes, n.° 359), et l’o nasal bugis répond ainsi exactement au son nasal du mot tagala. L’o nasal est souvent suivi, dans la prononciation, du son nasal ñg; mais ce son n’en forme pas une partie nécessaire. Il se détache dans la prononciation, et l’o reste nasal dans l’écriture: oulong, lune, ᨕᨘ ᨒ᩶ ; oulo tepou, pleine lune, ᨕᨘ ᨒ᩶ ᨙ ᨈ ᨄᨘ . L’o nasal se trouve aussi dans les mots qui ne se terminent pas par le son ñg; oloe, air, ᨕ᩶ ᨒ᩶ ᨙ ᨕ : il est même suivi de consonnes autre que ñg; alok bois ᨕ ᨒ᩶ ; tandis que cette consonne nasale peut être précédée par un o pur, tandjoñg ᨈ ᨍ ᨚ . Il résulte de tout cela que l’o nasal est un anouswara, qui peut encore être renforcé par la consonne nasale.
L’uniformité avec laquelle les différens alphabets dont j’ai parlé placent l’e et l’i à la gauche de sa consonne et en sens contraire de la direction de l’écriture, est très-singulière: l’alphabet javanais assigne la même place à l’e.
Les quatre lettres composées ᝨ ñgka, ᨇ mpa,
nra,
ñtcha, manquent dans mon vocabulaire; et ce qui est plus
singulier encore, c’est qu’au cas échéant, la première des deux consonnes
réunies n’est pas exprimée dans l’écriture bugis: elle n’est donc point
regardée, ainsi qu’on devait le croire d’après Raffles, comme initiale, mais comme terminant la syllabe
précédente; exemple: lempok (inondation) ᨙ ᨒ ᨄ᩶ ; onromalino (endroit retiré) ᨕ ᨚ ᨑ ᨚ ᨆ ᨄᨗ ᨊ ᨚ . Je ne
trouve pas d’exemple des syllabes ñgka et ñtcha.
Vous supposez, Monsieur, que le r initial est remplacé dans la langue tagala par l’y; vous m’excuserez si je ne puis partager cette opinion. Les deux lettres y et r, il est vrai, se permutent souvent dans ces dialectes; le pronom tagala siya, il, est indubitablement le sira javanais ou plutôt kawi: mais le r initial est remplacé par le d: on dit ratou et datou, roi, ka-datoan et karaton, palais. Les indigènes des Philippines confondent sans cesse le d et le r; mais de los Santos donne pour règle que le d doit être placé au commencement et le r dans le milieu des mots. Cette règle paraît constante pour le tagala; mais elle est aussi observée dans d’autres dialectes: le danau (mer) malais est le ranou (eau) de Madagascar et le dano ou lano de l’île de Magindanaõ. L’y entre aussi dans ces permutations, mais moins régulièrement, et dans la langue tagala, autant que je sache, jamais comme initiale. Un des exemples les plus frappans est le suivant. Ouir: dingig en tagala, ringue Madagascar, rongo Nouvelle-Zélande, roo Tahiti, onga tonga; Oreille: tayinga tagala, telinga malais, talinhe, tadigny, Madagascar, taringa Nouvelle-Zélande, taria Tahiti.
Vous avez expliqué d’une manière fort ingénieuse, Monsieur, comment on a pu se méprendre sur la direction des signes de l’écriture tagala, et vous avez réfuté en même temps l’opinion de quelques missionnaires espagnols sur l’origine de cet alphabet. Cette opinion est certainement erronée: je ne voudrais cependant pas nier toute influence de l’écriture arabe sur les alphabets de l’archipel indien. Vous observez, Monsieur, que, dans le § 11, page 152, dont je joins la copie à cette lettre, le P. Gaspar de S. Augustin écrit les mots gaby et gabe en caractères tagalais, de droite à gauche. Ce n’est là peut-être qu’une méprise du P. Gaspar. Mais ne pourrait-on pas supposer aussi que les indigènes, ou pour flatter leurs nouveaux maîtres, ou pour leur faciliter la lecture de leur écriture, l’ont en certaines occasions assimilée en ce point à l’arabe? Je soumettrai même à votre décision, Monsieur, une autre conjecture plus hasardée, mais plus importante. Vous témoignez avec raison votre étonnement de ce que l’alphabet bugis n’ait adopté que la première des voyelles initiales de l’alphabet tagala, et de ce que des deux alphabets, d’ailleurs si conformes, diffèrent l’un de l’autre dans un point aussi essentiel. J’avoue ingénuement que cette différence ne me paraît pas avoir dû toujours exister. Il est très-naturel de supposer que les Bugis ont eu, de même que les Tagalas, les trois voyelles initiales, mais que, voyant l’écriture malaie faire souvent servir l’a de signe introductif de voyelle initiale (Gr. malaie de Marsden, page 19), ils ont inventé une méthode analogue et ont laissé tomber en désuétude leurs deux autres voyelles initiales. Je conviens que le cas n’est pas tout-à-fait le même, puisque le و et le ﻯ arabes font en même temps les fonctions de voyelles et de consonnes, et que leur qualité de voyelles longues entre aussi en considération; mais ces nuances ont pu être négligées. Il est très-remarquable encore que des trois alphabets sumatrans, le batta ait les trois voyelles initiales, tandis que le redjang et le lampoung ont l’a seulement. Cette diversité est explicable dans mon hypothèse, puisque le hasard a pu faire que l’écriture arabe ait exercé une plus grande influence sur différens points de l’archipel. Mais hors de cette hypothèse, elle reste inconcevable dans les alphabets dont le principe est évidemment le même. Marsden ne dit pas, au reste, de quelle manière des Redjangs et les Lampoungs écrivent l’i et l’o initiaux; mais j’aime à croire qu’ils usent de la même méthode que les Bugis.
J’ai cru ne devoir pas m’éloigner de la supposition que le signe en question est vraiment un a, un signe de voyelle. S’il était permis de révoquer ce fait en doute, contre le témoignage des auteurs, toute difficulté serait levée par-là: le prétendu a n’aurait rien de commun avec les voyelles sanscrites et tagalas; il serait le signe d’une aspiration infiniment faible, un h, un v ou un y, et pourrait, comme une consonne, s’unir à toutes les voyelles.
L’erreur dans laquelle seraient tombés les auteurs à qui nous devons ces
alphabets, serait facile à expliquer. Comme, dans ces langues, toute consonne,
lorsqu’elle est indépendante, se prononce liée à un a,
ceux qui entendaient proférer un a avec une aspiration
très-faible, pouvaient regarder ce son comme celui d’une voyelle. Ce qui me
confirme dans cette opinion, c’est que mon vocabulaire bugis ne fournit aucun
signe pour le h, et que l’a thaï
() est rangé parmi
les consonnes. Le prétendu a bugis (ᨓᨘ) ressemble moins à
l’a (ᜀ) qu’au h (ᜑ) tagala, et
l’a (ꥆ) redjang n’a aucune ressemblance avec le
véritable a batta (ᯀ), tandis qu’à la position près, il a
la même forme que le pseudo-a lampoung (
). Mais ce qui me parait
presque décider la question, c’est que les signes de l’a
(ᨕ) et du w (ᨓ) bugis sont absolument les mêmes, à
l’exception d’un point ajouté au premier: les lettres h,
w, y de ces alphabets peuvent
être des consonnes plus prononcées. Si donc, Monsieur, vous ne trouvez pas trop
hardi de nommer h le signe que Low, Marsden et Raffles, d’après le témoignage des indigènes,
nomment a, j’abandonne l’hypothèse de l’influence arabe
sur ce point, en m’en tenant simplement à la supposition que ces peuplades,
d’après leur prononciation, ont admis dans leur alphabets les signes des
voyelles initiales, ou adopté à leur place un signe d’aspiration infiniment
faible, qui, sans presque rien ajouter au son des voyelles dans la
prononciation, peut néanmoins leur servir de consonne dans l’écriture. La
consonne h qui précède toute voyelle initiale des mots
javanais, est entièrement dans ce cas, et ressemble en cela au spiritus lenis que nous ne faisons pas entendre non plus en prononçant
les mots grecs.
Je ne suis cependant pas quitter cette question sans faire encore mention de l’alphabet barman. Il possède dix voyelles initiales et autant de médiales; et cependant il use de cette même méthode de lier à la première les signes médiaux de tous les autres, en écrivant aou pour ou. Carey (Gramm. barm. page 17, n.° 72) prescrit cette manière d’exprimer les voyelles initiales en les liant à un a muet, comme règle générale pour la formation des monosyllabes. Judson, dans la préface de son dictionnaire barman (page 12), s’exprime plus généralement. The symbol (la forme médiale) of any vowel, dit-il, may be combined with a (initial) in which case the compound has the power of the vowel which the symbol representes, thus ai is equivalent to i. Aucun de ces grammairiens ne dit à quel usage sont réservés les signes des autres voyelles initiales. Il faut cependant que l’usage en ait réglé l’emploi. Mais le nombre de mots où on les conserve est si peu considérable, que l’article de l’a occupe 42 pages dans le dictionnaire[e], tandis que ceux des autres neuf voyelles en remplissent huit; encore y a-t-il beaucoup de mots palis dans ces derniers. Lorsqu’on réfléchit sur cette circonstance et qu’on y ajoute cette autre, que la méthode de se servir de l’a comme une consonne est consacré particulièrement aux monosyllabes, on est tenté de croire que l’alphabet barman servait anciennement de la même méthode que l’alphabet des Bugis, celle de combiner les voyelles médiales avec l’a initial, et que l’usage des autres voyelles initiales n’a été introduit que postérieurement.
Je ne me souviens pas d’avoir rencontré la particularité dont nous parlons ici, dans aucun des alphabets dérivés du dévanagari et usités dans l’Inde même, à l’exception naturellement des cas où, comme dans la langue hindoustanie, on emploie l’alphabet arabe.
Il y a cependant, dans la langue telinga, un cas où l’a lié à une voyelle reste muet et conserve à la voyelle sa prononciation ordinaire; mais c’est pour la convertir de voyelle brève en voyelle longue. Campbell dit, en parlant de ces cas dans sa Teloogoo Grammar (page 10, n.° 23): In such cases, the symbol of the long vowel a is to be considered as lengthening the short vowel i, rather than as representing the long vowel a.
Au reste, je ne cite ces cas que parce qu’ils sont autant d’exemples, que l’a est chargé d’une fonction étrangère à son emploi primitif. La solution la plus simple du problème qui nous occupe ici, est sans doute de supposer que les peuples de ces îles, ayant à leur disposition des voyelles médiales et initiales, ont trouvé plus simple de se passer de ces dernières, et d’accoler les premières (lorsqu’elles n’étaient point précédées de consonnes) à l’a, qui, inhérent de sa nature aux consonnes, était la seule parmi les voyelles dont il n’existât pas de forme médiale. Le procédé n’en est pas moins étrange, et c’est pour cela que j’ai essayé de trouver une circonstance qui ait pu le faire adopter.
Les Tagalas trouvaient d’ailleurs, dans leur langue même, une raison particulière pour marquer bien fortement leurs trois voyelles, comme initiales de syllabes dans l’intérieur des mots. La langue tagala a deux accens, dont l’un prescrit de détacher entièrement la voyelle de la dernière syllabe d’un mot, de la consonne qui la précède immédiatement (haciendo que la sylaba postrera no sea herida de la consonante que la prefiere, sino que suene independente de ella (Gramm. de P. Gaspar de S. Augustin, pag. 154, n.° 3). Il faut donc lire pat-ir, big-at, dag-y, tab-a, et non pas pa-tir, &c. Comme, dans ce cas, la voix glisse légèrement sur la première syllabe, on a coutume de noter cet accent par les lettres p. c. (penultimâ correptâ); l’accent opposé, noté p. p. (penultimâ productâ), appuie sur la penultième et laisse tomber la finale. Il est de la plus grande importance de ne pas confondre ces deux accens; car un grand nombre de mots changent entièrement de signification, selon l’accent qu’on leur donne. C’est donc à cet usage que les Tagalas réservaient spécialement leurs voyelles initiales. Ils les employaient aussi au milieu des mots, là où il importait de renvoyer une consonne à une syllabe précédente et de commencer la suivante par une voyelle. C’est ce qui résulte clairement de l’extrait de grammaire que je joins à cette lettre, et le P. Gaspar observe très-judicieusement que c’était là un grand avantage de l’écriture indigène sur la nôtre.
Soulat et sourat sont sans aucun doute des mots arabes; Marsden l’observe expressément de sourat: on peut y ajouter le serrat des Javanais et le soratse de Madagascar. Veuillez encore remarquer la conformité grammaticale de ces quatre langues, qui forment de ces mots, manounoulat, meniourat, nyerrat, manorats, en changeant toutes le s en un son nasal. Il m’a été fort agréable d’apprendre qu’il existe dans la langue tagala une expression indigène pour l’idée d’écrire. Je ne connaissais pas le mot titic, qui ne se trouve pas dans le dictionnaire de de los Santos. Mais y aurait-il assez d’analogie entre toulis et titic pour dériver l’un de l’autre? Ce dernier ne serait-il pas plutôt le titik malais, qui veut dire goutte, mais aussi tache (idée qui n’est pas sans rapport à l’écriture)? Quant à toulis, qui est le toki de la langue tonga, j’ai toujours cru le retrouver dans le toulis tagala, pointe, aiguiser: on trace ordinairement les lettres avec un instrument pointu.
Nous venons de voir que les langues malaies font subir aux mots arabes les changmens de lettres de leurs grammaires; la même chose a lieu pour les mots sanscrits qui passent dans le kawi: boukti devient mamoukti; sabda, parole, devient masabda, dire, et sinabda, ce qui a été dit.
On est naturellement porté à regarder l’alphabet indien comme le prototype de tous les alphabets des îles du Grand Océan. Ces peuplades pouvaient, comme vous les dites, Monsieur, l’adapter chacune à la nature de sa langue et à son orthophonie. Cette opinion a été néanmoins contestée: quelques auteurs regardent comme très-probable que les différens alphabets ont été inventés indépendamment l’un de l’autre chez les différentes nations. Je ne puis partager cette opinion. Je ne nie point la possibilité de l’invention simultanée de plusieurs alphabets; mais ceux dont nous parlons ici sont trop évidemment formés, sans parler même de la ressemblance matérielle des caractères, d’après le même système, pour ne pas être rapportés à une source commune. Il n’existe pas de données historiques qui puissent nous guider dans ces recherches; mais il me semble que nous devons les diriger dans une voie différente, mettre un moment de côté tout ce qui est tradition ou conjecture historique, et examiner les rapports intérieurs qui existent entre ces alphabets, voir si nous pouvons trouver les chaînons qui conduisent de l’un à l’autre: car il semble naturel de supposer aussi, dans le perfectionnement des alphabets, des progrès successifs.
Les alphabets dont nous parlons ici ont cela de commun, qu’ils tracent les syllabes par des groupes de signes, dans lesquels la seule lettre initiale à laquelle on ajoute les autres comme accessoires est regardée comme constitutive. Ces alphabets, lorsqu’ils sont complets, se composent ainsi: 1.° de la série des consonnes et des voyelles initiales; 2.° de la série des voyelles proférées par les consonnes initiales; 3.° des consonnes qui se lient à d’autres consonnes sans voyelles intermédiaires; 4.° de quelques signes de consonnes, qui en terminant la syllabe, se lient étroitement à sa voyelle, tels que le repha, l’anouswara, le visarga. Si les consonnes finales des mots ne passaient pas ordinairement, dans l’écriture de ces langues, aux lettres initiales des mots suivans, il faudrait encore ajouter à cette dernière classe toutes les consonnes pourvues d’un virama. Ces alphabets se distinguent entièrement des syllabaires japonais: les syllabes n’y sont pas considérées comme indivisibles; on en reconnaît les divers élémens; mais cette écriture est pourtant syllabique, parce qu’elle ne détache pas toujours ces élémens l’un de l’autre, et parce qu’elle règle sa méthode de tracer les sons, d’après la valeur qu’ils ont dans la formation des syllabes, tandis qu’une écriture vraiment alphabétique isole tous les sons et les traite d’une manière égale.
Dans ce système commun, nous apercevons deux classes d’alphabets très-différens: les uns, tels que le dévanagari et le javanais, possèdent toute l’étendue des signes que je viens d’exposer; les autres, tels que le tagala, le bugis, et à ce qu’il paraît les sumatrans, se bornent aux deux premières classes de ces signes. Si l’on examine de plus près cette différence, on trouve qu’elle consiste en ce que les derniers de ces alphabets ne peuvent point détacher la consonne de sa voyelle, et que les premiers sont en possession de moyens pour réussir dans cette opération. Les alphabets tagala et bugis n’expriment en effet aucune consonne finale d’une syllabe; ils laissent au lecteur le soin de les deviner. La seule adoption du virama aurait levé cette difficulté, et l’on est étonné de voir que ces peuples l’aient exclu de leurs alphabets. Mais je crois que nous nous représentons mal la question, en transportant nos idées d’aujourd’hui et de notre prononciation à des époques où les langues étaient encore à se former, et à des idiomes tout-à-fait différens. Si l’invention et le perfectionnement d’un alphabet exercent une influence quelconque sur la langue dont il rend les sons, c’est certainement celle de contribuer au perfectionnement de l’articulation, c’est-à-dire, de l’habitude des organes de la voix de séparer bien distinctement tous les élémens de la prononciation. Si les nations, pour être capables de faire usage d’un alphabet, doivent déjà posséder cette disposition à un certain degré, elle augmente par cette invention, et l’écriture et la prononciation se perfectionnent mutuellement.
Le premier pas était fait par l’invention des lettres initiales des syllabes, des voyelles qui en formant une à elles seules et des consonnes accompagnées de leurs voyelles.[f] Les langues dont nous parlons ici forment presque tous leurs mots de syllabes simples se terminant en voyelles; on pouvait donc, jusqu’à un certain degré, se passer des moyens de marquer aussi les consonnes finales: dans les 200 mots que renferme la première feuille du vocabulaire bugis, je ne trouve de consonnes finales que m, n, k, h, ñg, les deux premières dans l’intérieur des mots seulement, m devant p, n devant r; h et k ne paraissent qu’à la fin des mots, mais ñg occupe les deux places et est employé plus souvent que les autres.
Il n’était cependant pas si aisé d’aller plus loin. On ne pouvait écrire la terminaison des syllabes composées qu’en faisant une double opération. Après avoir privé la consonne finale de sa voyelle inhérente, par laquelle elle aurait formé une nouvelle syllabe, il fallait encore, pour en isoler entièrement le son, la détacher de la voyelle qui la précédait immédiatement; car le son de la consonne et celui de la voyelle se confondaient. Il faut observer en effet que les peuples qui se servaient d’alphabets semblables à ceux des Bugis et des Tagalas, ne croyaient pas représenter leurs syllabes d’une manière incomplète: ils ne voyaient pas, comme nous, dans les signes de leurs voyelles finales, un i ou un u seulement, mais, selon les circonstances aussi, un ik, un ing, &c; ils ne concevaient pas même la possibilité de décomposer encore des sons déjà si simples. Le virama privait bien la consonne de sa voyelle inhérente; mais l’opération de détacher la consonne de la voyelle qui la précédait, était plus difficile: car la voyelle qui s’exhale, pour ainsi dire, en consonne, rend naturellement un son plus obscur et moins distinct que la consonne qui commence la syllabe; de même la voyelle qui est coupée par une consonne finale, se trouve arrêtée dans sa formation. Il résulte des deux cas que la voyelle et la consonne des terminaisons de mots se modifient mutuellement.
L’écriture barmane offre un exemple très-curieux de ces modifications; j’observe que cette particularité se trouve dans les monosyllabes, qui constituent le font primitif de cette langue. Les consonnes, lorsqu’elles viennent à terminer un mot, recoivent dans presque tous les cas une autre valeur, et altèrent même celle de la voyelle qui les précède. Le monosyllabe écrit kak, est prononcé ket, un p final devient t, un m final n, &c. (Carey, page 19; Judson, p. 13). On se demande naturellement d’où il vient que l’écriture ne suive pas ici la prononciation: si l’on prononce constamment t, d’où sait-on que ce t est proprement un k ou un p? L’étymologie du monosyllabe renferme, très-probablement, la réponse à ces questions. Les racines se terminant en une consonne bien prononcée, peuvent être et sont vraisemblablement, pour la plupart, des mots composés, la combinaison des syllabes japonaises, par exemple, offre des cas ou de deux syllabes ainsi réunies, la dernière perd sa voyelle. De fa-tsou vient fat (Gramm. japonaise de Rodriguez, publiée par M. Landresse, p. 27). Or il ne serait pas étonnant qu’une consonne qui, comme initiale, se prononçait k, changeât de valeur en devenant finale. Quoi qu’il en soit, cette divergence de l’écriture et de la prononciation des monosyllabes barmans, ne permet pas de méconnaître qu’il existe encore dans la langue une lutte qu’il serait important de faire cesser, entre les deux grands moyens de représenter la pensée.
Les voyelles se terminent souvent aussi, et sur-tout dans les langues dont nous parlons ici, en des sons qui ne s’annoncent pas comme des consonnes très-prononcées, mais seulement comme des aspirations ou des sons nasaux qu’il serait difficile ou même impossible de réduire en articulations. Le sanscrit même a dû encore accorder une place dans son alphabet à deux caractères, le visarga et l’anouswara, qu’on ne peut considérer comme de véritables lettres, sous le rapport de la clarté et de la précision de leur son. M. Bopp a en effet prouvé, dans son excellente grammaire sanscrite, que l’anouswara, bien qu’il ne fasse souvent que remplacer les autres lettres nasales, possède aussi un son à lui, qui n’est représenté par aucune autre lettre.
Il restait donc, sous tous les rapports, beaucoup de chemin à faire pour arriver de l’alphabet tagala au dévanagari.
D’après ce que je viens d’exposer, il me semble évident qu’il existe, dans les deux classes d’alphabets désignées ici, une tendance progressive au perfectionnement de l’écriture. Je ne prétends cependant pas soutenir, sur ces données seules, que telle ait été réellement la marche historique de ce perfectionnement, et bien moins encore que l’alphabet tagala ait nécessairement dû servir d’échelon pour s’élever au dévanagari: je me borne, pour le moment, simplement à prouver, par la nature même de ces alphabets, qu’ils sont réellement du même genre; mais que le dévanagari complète le travail que le tagala et ceux qui lui ressemblent laissent imparfait.
Comme le système de ces alphabets moins parfaits est renfermé, pour ainsi dire, dans le système plus étendu du dévanagari, on peut supposer que les Tagalas n’ont pris de cet alphabet venu à leur connaissance que ce qu’il fallait à leur langue, beaucoup plus simple et moins riche dans son système phonétique. L’alphabet tagala serait, d’après cela, le dévanagari en raccourci. Mais c’est cette supposition sur-tout que je voudrais combattre; elle me semble être dénuée de toute probabilité. Quelque simple que soit l’alphabet tagala, il est complet dans son système; et dès qu’on lui accorde le principe sur lequel il est calqué, de ne noter les syllabes composées que par leurs voyelles seulement, il ne s’y trouve rien de superflu ni de défectueux. Il aurait été vraiment difficile d’abstraire aussi méthodiquement du dévanagari un système qu’il renferme en effet, mais qui ne forme que la moitié de sa tendance vers l’écriture alphabétique. Les syllabes des mots tagalas sont pourtant assez souvent terminées par des consonnes suffisamment prononcées; l’inconvénient de ne pas les noter se fait considérablement sentir, comme nous le voyons par le témoignage des missionnaires espagnols: pourquoi donc aurait-on repoussé l’adoption du virama, moyen si simple et si facile à adapter à toute écriture? La langue barmane est, sous le rapport de la formation des mots, pour le moins tout aussi simple que la langue tagala; elle a cependant adopté, même dans la partie qui lui est entièrement propre, tout les moyens de marquer les sons que le dévanagari lui offrait. Le même cas existe chez les Javanais et les Telougous: L’alphabet tamoul est moins nombreux en signes, mais fait également usage du virama et de la réunion des consonnes par ce moyen. Pourquoi, si le dévanagari, dans l’état où nous le connaissons à présent, avait donné origine à leurs alphabets, les Tagalas, les Bugis et les Sumatrans n’auraient-ils pas fait de même? On peut dire que les Hindous avaient des établissemens moins fixes dans ces pays; mais cette circonstance, qui n’est même pas exacte pour Sumatra, change à l’état de la question: car il est beaucoup moins croyable qu’on ait pu à la hâte adapter l’alphabet hindou aux langues indigènes, d’une manière à-la-fois aussi méthodique et aussi incomplète.
Mais ce qui tranche la question, c’est qu’un examen plus réfléchi du dévanagari lui-même prouve qu’il a existé avant lui peut-être plus d’un alphabet dressé sur le même système, mais moins parfait que lui. Le dévanagari est visiblement sorti d’un système syllabique d’alphabets; il n’est pas une invention, mais seulement un perfectionnement du système. Le dévanagari ne se distingue d’une écriture vraiment alphabétique que par des choses qu’avec raison l’on peut nommer accessoires. Traiter l’a bref de voyelle inhérente aux consonnes, se servir par cette raison du virama, placer l’i bref avant sa consonne, combiner les signes des consonnes au lieu de les écrire l’une après l’autre, voilà les seules différences entre lui et l’alphabet grec ou toute autre écriture alphabétique. L’isolement des syllabes dans les manuscrits est plutôt une habitude purement calligraphique. Les inventeurs du dévanagari avaient certainement, aussi bien que nous, le principe de l’écriture alphabétique; ils avaient franchi la grande difficulté qui arrête le progrès de la prononciation à l’écriture; ils savaient détacher en tout sens les voyelles des consonnes, ils leur assignaient leurs limites et les marquaient avec précision. S’ils n’avaient eu aucun alphabet déja |sic| existant sous les yeux, s’ils avaient dû travailler tout à neuf, ils auraient très-probablement formé une écriture alphabétique; car pourquoi, sachant parfaitement bien détacher les voyelles des consonnes et leur assigner leurs valeurs d’après leurs différentes positions, auraient-ils, par exemple, renfermé une voyelle dans une consonne, pour l’en détacher un moment après par un signe inventé pour cet usage? Mais ils ont visiblement pris à tâche de perfectionner une écriture syllabique au point qu’elle rendit tous les services d’une écriture alphabétique; car voilà ce qu’on peut dire de l’admirable arrangement du dévanagari.
Je ne crois pas que l’écriture alphabétique ait dû être nécessairement précédée de l’écriture syllabique; une telle supposition me paraît trop systématique: mais toute la structure du dévanagari me semble prouver qu’il n’a pas été fait d’un jet. Tout y est explicable, dès qu’on suppose qu’on a voulu rendre plus parfait un système déjà existant, remplir les lacunes, corriger ses défauts; sans cette supposition, il est inconcevable comment, connaissant si bien la nature des sons, étant habitué à les faire passer par toute la série de leurs modifications, sachant parfaitement balancer et contre-balancer leurs valeurs dans la formation des mots, on ait voulu se traîner encore dans la route des écritures syllabiques, tandis que l’écriture alphabétique est évidemment la seule véritable solution du grand problème de peindre la parole aux yeux. Je crois donc que l’alphabet tagala, avec tous ceux qui sont basés sur le même système, appartient à une classe d’alphabets antérieurs au dévanagari, ou du moins qu’il n’en est pas tiré. On pourrait plutôt croire ces alphabets des îles entièrement étrangers à l’alphabet du continent de l’Inde (et, dans ce cas, ils pourraient même lui être postérieurs), si la ressemblance des caractères ne s’opposait pas à une pareille supposition.
Je trouve avec vous, Monsieur, l’alphabet tagala très-remarquable, puisqu’il offre précisément la moitié du travail qu’il fallait faire pour se former une écriture capable de représenter la prononciation toute entière. Il appartient à la même classe que le dévanagari; je n’oserais décider si, pour cela, cet alphabet est d’origine indienne. De plus profondes recherches prouveront peut-être que la partie fondamentale du sanscrit a de fréquentes affinités avec les langues à l’est de l’Inde et avec celles des îles; les Hindous auraient donc bien pu avoir des alphabets d’une nation de ces contrées devant les yeux. Ce qui me paraît certain, c’est que les alphabets syllabiques, ceux sur-tout du genre de l’alphabet tagala, ont des rapports fort intimes avec la structure des langues monosyllabiques de ces contrées, et avec le passage de cet état des langues à un autre plus compliqué. Autant que chaque syllabe forme un mot à elle seule, les syllabes sont simples, mais variées dans les modifications et les accens des voyelles; on note alors facilement l’articulation principale, et l’on néglige impunément le reste: mais si des nations viennent à réunir plusieurs syllabes dans le même mot, et qu’elles visent à donner à chaque mot l’unité d’un ensemble, en quoi repose principalement l’artifice grammatical des langues dans le sens le plus étendu, il arrive des compositions, des contractions, des intercalations. Alors nait la tendance vers l’écriture alphabétique: car on sent, en voulant tracer les mots, la nécessité d’aller aux premiers élémens, pour avoir la liberté de les réunir entièrement à volonté. Le dévanagari et le système grammatical que nous admirons dans le sanscrit datent probablement à-peu-près de la même époque; une langue tellement organisée supposait une nation à laquelle le dernier perfectionnement et même l’invention de l’alphabet ne pouvaient pas rester long-temps étrangers. Le tagala était évidemment resté en arrière, avec son alphabet beaucoup trop borné pour la structure grammaticale de la langue.
Rien, au reste, n’empêcherait aussi que les habitans des Philippines fussent redevables de leurs alphabets aux Hindous. L’influence de l’Inde sur l’archipel qui l’avoisine a été exercée de manières et à des époques fort différentes; et l’on reconnaît ces époques, en quelque façon, au genre et à la coupe des mots que les langues de ces contrées ont adoptés du sanscrit. Les communications avec les Philippines m’ont paru, d’après ces considérations, être très-anciennes: le difficile est seulement de trouver une époque où l’on pourrait attribuer à l’Inde un alphabet aussi incomplet. Le sanscrit n’a certainement jamais pu être écrit par son moyen. Il est donc peut-être plus juste de dire que ces alphabets sont d’origine inconnue, que leur prototype doit être d’une haute antiquité, qu’il a servi de base au dévanagari lui-même; mais que c’est toujours de l’Inde que l’alphabet indien a obtenu tous les perfectionnemens de son système. Le dévanagari lui-même a éprouvé des changemens; mais si je nomme cet alphabet, je parle seulement de sa constitution, et plus particulièrement du principe qui tend en lui à réunir, dans l’écriture syllabique, tous les avantages de l’écriture alphabétique.
.............................
Votre interprétation du passage de Diodore[g] me semble très-juste, Monsieur, et elle a le mérite de prouver combien ce passage est remarquable. Je n’hésite pas à avancer, que c’est le seul, dans tous les auteurs grecs et romains, où une propriété très-particulière d’une langue étrangère ait été saisie avec autant de justesse. Le principe fondamental des alphabets syllabiques de l’Asie orientale y est exposé clairement; mais personne ne l’y avait découvert avant vous. Je prends avec vous, Monsieur, les γράμματα pour les groupes syllabiques, et les χαρακτῆρας pour les consonnes; non pas que Diodore les ait reconnues comme telles, mais parce que, dans ces alphabets, les consonnes seules s’annoncent par leurs formes comme de véritables lettres. Je crois donc que Diodore parle d’abord du nombre des signes de tout le syllabaire, et qu’il passe de là à celui des consonnes et des voyelles. Ce sont ces nombres seuls que je crois erronés dans le texte de Diodore, et encore ne le sont-ils que pour leur valeur: les rapports dans lesquels ils se trouvent sont parfaitement justes; car le nombre des signes du syllabaire est le plus considérable, et égal au produit de celui des consonnes multipliées par les voyelles. Il ne me paraît pas nécessaire de faire entrer les vargas dans le passage; c’est en quoi seulement je voudrais, Monsieur, différer de votre opinion.
.....................................
Tegel, ce 10 décembre 1831.G. de Humboldt.
Ier Extrait. (Compendio de la arte de la lengua Tagala, por el
Padre Fr. Gaspar de Sant-Agustin,
[año 1703]. Segunda impression. Pueblo de
Sampaloc, año de 1787.) 11. Infinitas palabras se equivocan en nuestro escribir, que en caracteres
tagalos se distinguen; y assi se tendrà cuydado con el accento en la
penultima, sopena de decir uno por otro. Porque gaby
assi escrito es equivoco de noche y gabe; pero pronunciado noche sera ᜁᜄ
gab-y, y gabe
ᜊᜒᜄ dirà ga-bi: olol es equivoco, porque ᜂᜎ
o-lol es llenar; y ᜂᜂ
ol-ol es loco. § VI. De los caracteres y escrituras. 1. Por ultimo pondré el modo, que tenian de escribir antiguamente, y al
presente lo usan en la Comintan y otras partes. Los caracteres son
aprendidos de los Malayos y son diez y siete: las tres vocales, que
equivalen à las cinco nuestras; las catorce consonantes, cuya forma y valor
es este. II. Vocales. Las consonantes. Poniendo à estos un punto arriba, hieren en i ò e; v.g. Si tubieren el punto abaxo, hieren en o ò u; v.g. 3. Entre cada diccion ponen esta nota ! que es toda su ortografia. 4. Es escritura tan facil de escribir, como dificil de leer, porque es
adivinar; porque estas dos letras ᜎᜒᜎᜒ|| se pueden leer de ocho modos, que
son lili, lilim, lilip, lilis, lilit, liling, liclic, liglig; y con toto
esso se entienden. Item ᜊᜆ|| se puede leer bata, batang, bantay, batar, batac, banta, batay; y con todo
yerran pocas veces. IIe Extrait. (Arte de la lengua Bisaya de la provincia
de Leyte, compuesta por el
P. Domingo Ezguerra; reimpressa en
Manila [año de 1747], in-4°). Del modo de escrivir de estos naturales, y de sus
letras. Solian antes de agora (y aun muchos oy dia) escrivir de abajo hazia arriba,
poniendo el primer renglon hazia la mano izquierda. Las letras son diez y
siete, de las quales, las tres son vocales, que equivalen à las cinco
nuestras vocales: las demas son consonantes. Las letras que tienen, son las
que se siguen.
ᜀ
ᜁ
ᜂ
a
e, i
o, u
ᜊ
ᜃ
ᜇ
ᜄ
ᜅ
ᜑ
ᜎ
ᜋ
ᜈ
ᜉ
ᜐ
ᜆ
ba
ca
da, ra
ga
ñga
ha
la
ma
na
pa, fa
sa
ta
ᜏ
ᜌ
va
ya
be
ke
de, re
ge
ñge
he
le
me
ne
pe, fe
se
te
ᜊᜒ
ᜃᜒ
ᜇᜒ
ᜄᜒ
ᜅᜒ
ᜑᜒ
ᜎᜒ
ᜋᜒ
ᜈᜒ
ᜉᜒ
ᜐᜒ
ᜆᜒ
bi
ki
di, ri
gi
ñgi
hi
li
mi
ni
pi, fi
si
ti
ve
ye
ᜏᜒ
ᜌᜒ
vi
yi
bo
co
do, ro
go
ñgo
ho
lo
mo
no
po, fo
so
to
ᜊᜓ[3]
ᜃᜓ
ᜇᜓ
ᜄᜓ
ᜅᜓ
ᜑᜓ
ᜎᜓ
ᜋᜓ
ᜈᜓ
ᜉᜓ
ᜐᜓ
ᜆᜓ
bu
ku
du, ru
gu
ñgu
hu
lu
mu
nu
pu, fu
su
tu
vo
yo
ᜏᜓ
ᜌᜓ
vu
yu
Fußnoten
- 1 |WvH| Voyez ces extraits à la suite de la lettre.
- 2 |WvH| La forme du p se
rapproche, comme vous voyez, de celle du troisième alphabet de Raffles (
).[d]
- 3 |Jacquet| Il y a après cette lettre un caractère que je ne reproduis point ici, parce qu’il n’est pas assez nettement tracé dans le manuscrit. E.J.
- a |Editor| Totanes 1745, fol. 2 (libro 1). [FZ]
- b |Editor| Siehe die in der Beilage nach S. clxxxvlii im zweiten Band von Raffles 1817 wiedergebenen Alphabete des Ugi (bzw. Bugis). In der zweiten Auflage von 1830 ist die Tabelle nicht mehr vorhanden.[FZ]
- c |Editor| Low 1824, S. 3. [FZ]
- d |Editor| Siehe oben Anm. b. [FZ]
- e |Editor| Judson 1826, S. 1–42. [FZ]
- f |Editor| Schließender Punkt ergänzt.
- g |Editor| Siehe Jacquet 1831, S. 20–30. [FZ]