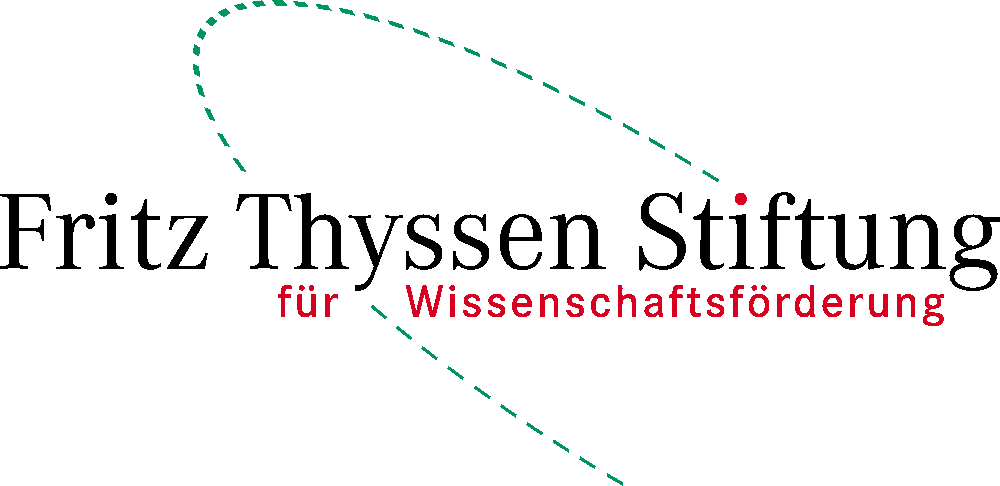Wilhelm von Humboldt an Jean-Pierre Abel-Rémusat, 07.03.1826 [„Lettre à Monsieur Abel-Rémusat“]
[ <A> Mr. Abel-Rémusat.]<NB. bleibt jetzt weg.>
Monsieur,
Je me suis occupé du chinois, ainsi que Vous avez bien voulû me le conseiller, Monsieur, et la facilité admirable que Vous avez portée dans cette étude par Votre Grammaire & par l’édition du Tchoûng-yoûng, a secondé mes efforts. J’ai comparé attentivement les textes chinois, renfermés dans ces deux ouvrages, avec la traduction que Vous en donnez, et j’ai tâché de me rendre compte par ce moyen de la nature particulière de la langue chinoise. Etant parvenû à fixer jusqu’à un certain point mes idées là-dessus, je vais Vous les soumettre, Monsieur, & je prends la liberté de Vous prier de vouloir bien les examiner & les rectifier. Je ne puis avoir qu’une connoissance bien imparfaite encore de la langue chinoise, et il est dangereux de hasarder un jugement sur le génie et le caractère d’une langue sans en avoir fait une étude approfondie. J’ai donc grand besoin d’être guidé par Vos bontés dans une carrière neuve & difficile.
La première impression que laisse la lecture d’une phrase Chinoise,[a] est que cette langue s’éloigne à peu près de toutes celles que l’on connoît; mais en fait de langues il faut se garder d’assertions générales. Il seroit difficile de dire que la langue Chinoise différât entièrement de toutes les autres. Je m’arrêterai, pour avoir un point fixe de comparaison, d’abord surtout aux langues classiques; j’aurai principalement elles en vue, lorsque je parlerai du Chinois en opposition des autres langues, j’examinerai plus tard s’il y en a réellement qui conviennent plus ou moins avec lui.
Je crois pouvoir réduire la différence de la langue Chinoise des autres langues au seul point fondamental que, pour indiquer la liaison des mots dans ses phrases, elle ne fait point usage des catégories grammaticales, et ne fonde point sa grammaire sur la classification des mots, mais fixe d’une autre manière les rapports des élémens du langage dans l’enchaînement de la pensée. Les grammaires des autres langues ont une partie étymologique & une partie syntactique; la grammaire Chinoise ne connoît que cette dernière.
De là découlent les lois et les particularités de la phraséologie Chinoise, et dès qu’on se place sur le terrain des catégories grammaticales, on altère le caractère original des phrases Chinoises.
Vous trouverez peut-être, Monsieur, ces assertions trop étendues & trop positives, ou Vous supposerez que j’aye voulû dire simplement que la langue Chinoise néglige d’attacher aux mots les marques des catégories grammaticales , et ne poursuit pas cette classification jusqu’aux dernières ramifications. J’avoue cependant que la langue Chinoise me semble moins négliger que dédaigner de marquer les catégories grammaticales, et se placer, autant que la nature du langage le comporte, sur un terrain entierement différent. Mais je sens que ceci exige des développemens d’idées & des preuves de fait; et je vais Vous soumettre, Monsieur, ce qui dans mes réflexions générales sur les langues & dans mes occupations Chinoises, m’a conduit à ce que je viens d’avancer.
Je nomme catégories grammaticales les formes grammaticales des mots; c’est à dire les parties d’oraison et les autres formes rangées sous elles. Ce sont des classes de mots qui leur attribuent certaines qualifications grammaticales, qui sont reconnues ou à des marques inhérentes aux mots mêmes, où à la place que les mots occupent, ou à la liaison de la phrase.
Aucune langue peut-être ne distingue, ni ne marque toutes ces formes, mais on peut dire qu’une langue les emploie à l’ indication de la liaison des mots, si elle fait de cette classification la base de sa grammaire, si au moins les formes ou catégories principales sont reconnoissables, indépendamment du sens du contexte, et si la nature de la langue porte l’esprit de ceux qui la parlent, à assigner chaque mot à une de ces classes aussi là où il n’en porte point les marques distinctives.
La classification des mots d’après les catégories grammaticales tire son origine d’une double source: de la nature de l’expression de la pensée par le langage et de l’analogie qui regne entre ce dernier et le monde réel.[b]
Comme on exprime en parlant les idées par des mots qui se succèdent, il doit exister un ordre déterminé dans la combinaison de ces élémens, pour en former l’ensemble de l’idée exprimée, et cet ordre doit être le même celui qui parle et dans celui qui écoute, pour rendre l’intelligence mutuelle. C’est là la base de toute grammaire. Cet ordre établit nécessairement des rapports entre les mots d’une phrase et entre ces mots & l’ensemble de l’idee, et ces rapports, considérés dans leur généralité, & abstraction faite des idées particulières auxquelles ils s’attachent, nous donnent les catégories C’est donc par l’analyse de la pensée convertie en paroles qu’on parvient à déduire les formes grammaticales des mots. Mais cette analyse ne fait que développer ce qui se trouve déjà originairement dans l’esprit de l’homme doué de la faculté du langage; et parler d’après ces formes, et s’élever a leur connoissance par la réflexion sont deux choses entièrement différentes. Car l’homme ne se comprendroit ni soi-même, ni les autres, si ces formes ne se trouvoient pas comme des archétypes dans son esprit, ou pour me servir d’une expression plus rigoureusement juste, si sa faculté de parler n’étoit soumise, comme par une espèce d’instinct naturel, aux lois que ces formes imposent.
Les catégories grammaticales se trouvent en relation intime avec l’unité de la proposition; car elles sont des exposans des rapports des mots à cette unité, et conçues avec précision et clarté, elles marquent davantage cette unité et la rendent sensible. Les rapports des mots doivent augmenter et varier à proportion de la longueur et de la complication des phrases, et il en résulte naturellement que le besoin de poursuivre la distinction des catégories ou formes grammaticales jusque dans leurs dernières ramifications naît surtout de la tendance à former des périodes longues & compliquées. Là où des phrases entrecoupées dépassent rarement les limites de la proposition simple, l’intelligence ne rend guère nécessaire de se représenter exactement les formes grammaticales des mots, ou d’en porter la distinction jusqu’au point où chacune paroit dans toute son individualité. Il suffit pour lors très-souvent de savoir qu’un tel mot est le sujèt de la proposition sans se rendre compte exactement, s’il est substantif ou infinitif, qu’un autre en détermine un troisième sans se décider, s’il faut le prendre pour participe ou adjectif.
On voit par là qu’il est possible de parler et d’être compris sans s’assujettir à marquer ou même à distinguer exactement les formes grammaticales des mots. Ces formes ne s’en trouvent pas moins dans l’esprit de celui qui en use ainsi, il n’en suit pas moins les lois, mais il exprime sa pensée de manière à pouvoir se borner à une application générale de ces lois. Il n’est pas dans le besoin de les spécifier, et les formes grammaticales des mots n’étant point spécifiées par tout ce qui distingue chacune d’elles, ne peuvent pas proprement agir sur son esprit, ni diriger principalement son langage. Mais avant que de poursuivre ce point extremement important pour toute recherche sur la langue Chinoise, je vais passer à l’analogie entre le langage et le monde réel, comme donnant également lieu à classer les mots dans diverses catégories purement grammaticales.
Les mots se placent naturellement dans les catégories auxquelles appartiennent les objèts qu’ils représentent. C’est ainsi qu’il existe dans toute langue des mots de signification substantive, adjective & verbale, et les idées de ces trois formes grammaticales naissent très naturellement de là. Mais ces mêmes mots peuvent aussi être adaptés à une autre catégorie, celui dont l’idée est substantive, peut être transformé en verbe ou vice versa. Il y a en outre des mots dont la signification ideale ne trouve point une pareille analogie dans le monde réel, et ces mots aussi peuvent être classifiés à l’instar des autres. Il existe donc dans chaque langue deux espèces de mots, l’une se compose de mots à qui leur signification, l’objèt qu’ils représentent (substance, action ou qualité) assigne leur catégorie grammaticale, l’autre de mots qui n’etant point dans le même cas, peuvent être pris dans plus d’une, selon le point de vue sous lequel on les envisage. La manière dont une langue traite ces derniers, est de la plus grande importance. Si elle les place également dans ces catégories et leur en donne la forme, ces mots ont vraîment une valeur grammaticale, sont réellement des substantifs ou des verbes; car ces rapports[c] en eux n’existent qu’en idée, n’ont été aperçus que par une manière particulière de regarder le langage, et servent[d] par cette même raison à son usage. Si au contraire les catégories de ces mots restent vagues et indéterminées, aussi ceux dont la signification annonce la catégorie, n’ont plus une valeur grammaticale, ne sont pas des verbes ou des substantifs, mais simplement des expressions d’idées verbales ou substantives. Car les rapports de verbes et de substantifs ne leur ont point été assignés ni par, ni pour le langage dans lequel on peut former beaucoup de phrases sans leur secours. Même dans les phrases où ils entrent, ils n’agissent pas toujours grammaticalement dans la qualité que leur signification annonce. L’expression d’une idée verbale ne forme pas nécessairement, ainsi que c’est le caractère distinctif du verbe, la liaison entre le sujèt et l’attribut de la proposition. L’expression d’une idée substantive peut s’attacher au régime de la même manière que le feroit grammaticalement le verbe, quoique le substantif, passe en infinitif, dès que, sans l’intermédiaire d’une préposition, il prend un complément direct.
On ne peut donc parvenir aux catégories grammaticales, par cette voye que lorsqu’une nation possède une tendance à regarder la langue qu’elle parle, comme un monde à lui, mais analogue au monde réel, à voir dans chaque mot un individu, & à ne pas souffrir qu’il y en ait qu’on ne puisse assigner à une classse quelconque. Cette tendance naîtra surtout du travail de l’imagination, appli-quée au langage, & dans les langues qui excellent par une grammaire riche & variée, ce travail paroit avoir développé l’instinct intellectuel dont j’ai parlé plus haut.
Dans les langues qui ne distinguent qu’imparfaitement les catégories grammaticales, ou dans lesquelles cette distinction semble disparoître entièrement, il faut néanmoins que les mots enchainés dans la phrase, ayent une valeur grammaticale outre leur valeur matérielle ou lexicale.[e] Mais cette valeur n’est pas reconnoissable dans le mot pris isolément, ou du moins pas indépendamment de sa signification. Elle résulte ou de cette dernière, si l’objèt que le mot représente, ne peut appartenir qu’à une catégorie seulement, ou de l’habitude d’assigner à une catégorie un mot qui, selon sa signification, pourroit appartenir à plusieurs, ou de l’emploi dans la phrase et dans ce cas de l’arrangement des mots, fixé comme règle grammaticale, ou du sens du contexte. Car ce sont là, il me semble, les différentes manières dont la valeur grammaticale peut s’annoncer dans les langues.
Dans une même langue les mêmes idées grammaticales occupent ou plutôt les memes lois grammaticales dirigent celui qui parle et celui qui écoute. Si ce dernier est étranger et qu’il parle une langue de structure différente, il y porte les siennes.[f] Si la grammaire qui lui est habituelle est plus parfaite, il exige dans chaque mot de la langue étrangère une précision égale de l’expression de la valeur grammaticale, et il n’y a aucun doute que dans chaque phrase d’une langue quelconque chaque mot (si on lui applique ce système) ne peut être assigné à une catégorie grammaticale à laquelle,[g] seule il peut appartenir, si l’on pèse exactement le sens et la liaison des idées exprimées. Car la grammaire, bien plus que toute autre partie de la langue, existe essentiellement dans l’esprit, étant sa manière de lier les mots pour exprimer et concevoir des idées, et tous ceux, qui s’occupent d’une langue étrangère y arrivent, s’il m’est permis de me servir de cette image, avec des cases toutes préparées pour y ranger les élemens qu’elle leur présente. La grammaire qu’on trouve dans une langue par cette manière d’interpretation, n’est donc pas toujours celle qui y existe réellement. La véritable grammaire d’une langue s’y présente d’une manière reconnoissable à des marques inhérentes aux mots, ou à des mots grammaticaux, ou à la position fixée d’après des lois constantes, ou elle existe, sous-entendue, dans l’esprit de ceux qui la parlent. mais se manifeste par la coupe et la tournure des phrases.
En parlant ici des diverses manières d’exprimer la valeur grammaticale des mots,[h] j’ai surtout eû en vue le degré de précision que les nations portent dans cette expression. Le plus haut se trouve dans la distinction des catégories grammaticales jusque dans leurs dernières ramifications, et comme l’homme parvient à cette distinction d’un côté en analysant la pensée énoncée en paroles, et d’un autre en traitant et maniant d’une manière particulière la’ |sic| langue qui en est l’organe, nous touchons ici à ce qu’il y a de plus intime et de plus profond dans la nature des langues, au rapport primitif qui existe entre la pensée & le langage.
Tout jugement de l’esprit est une comparaison de deux idées dont on prononce la convenance ou la disconvenance. Tout jugement peut en conséquence être réduit à une équation mathématique. C’est cette forme première de la pensée que les langues revêtent de la leur en unissant les deux idées d’une manière synthétique, c’est à dire en y ajoutant l’idée de l’existence. Elles se servent pour cet effèt du verbe fléchi qui est la réalisation de l’idée verbale, et qui ne se trouve que dans la pensée parvenûe au comble de sa précision et de sa clarté par le moyen du langage. C’est par là que le verbe devient le centre de la grammaire de toutes les langues.
Si l’on examine l’opération que l’homme, souvent sans s’en apercevoir, fait en parlant, c’est une prosopopée continuelle. Dans chaque phrase un être idéal (le mot qui constitue le sujet de la proposition) est mis en action ou représenté en étât de passivité.
L’action intérieure par laquelle on on forme un jugement, est rapportée à l’objet sur lequel on prononce. Au lieu de dire: je trouve les idées de l’être suprême et de l’éternité identiques, l’homme pose ce jugement au dehors de lui et dit: l’être suprême est éternel. C’est là, si j’ose me servir de cette expression, la partie imaginative des langues. Elle doit nécessairement exister dans chacune d’elles, puisqu’elle tient à l’organisation intellectuelle de l’homme et à la nature du langage, mais les développemens qu’elle reçoit, le point auquel elle est cultivée, dépendent du génie particulier des nations. Les langues classiques la portent à son comble, la langue Chinoise n’en adopte que ce qui est absolument indispensable pour parler et être compris.
Les nations peuvent ainsi, en formant les langues, suivre deux routes extrêmement différentes; s’attacher foncièrement aux rapports des idées comme telles,[i] s’en tenir avec sobriété à ce que exige leur énonciation, claire & précise, exige indispensablement, & prendre aussi peu que possible de ce qui appartient à la nature particulière de la langue, comme organe et instrument de la pensée; ou cultiver surtout la langue, comme instrument, s’attacher à sa manière de représenter la pensée, l’assimiler, comme un monde idéal, au monde réel sous tous les rapports qui peuvent y être appliqués.
La distinction des genres des mots, propre aux langues classiques, mais négligée par un grand nombre d’autres, offre un exemple frappant de ce que je viens d’avancer. Elle appartient entièrement à la partie imaginative des langues. L’examen de la pensée & de ses rapports intellectuels ne sauroit y conduire; regardée de ce point de vue, elle seroit même rangée facilement parmi les imperfections des langues, comme peu philosophique, superflue & déplacée. Mais dès que l’imagination active & fraiche d’une nation vivifie tous les mots, assimile la langue entièrement au monde réel, en achève la prosopopée, en faisant de chaque période un tableau dont l’arrangement des parties & les nuances appartiennent plus à l’expression de la pensée qu’à la pensée même, les mots doivent avoir des genres, comme les êtres vivans appartiennent à un sexe. Il en résulte ensuite des avantages techniques dans l’arrangement des phrases, mais pour les apprécier et en sentir le besoin, une nation doit être frappée surtout de ce que la langue ajoute à la pensée en la transformant en parole.
Je crois avoir suffisamment développé jusqu’ici l’origine de la distinction des formes grammaticales dans les langues. Je ne les regarde point comme le fruit des progrès qu’une nation fait dans l’analyse de la pensée, mais plutôt comme résultant de la manière dont une nation regarde et traite sa langue. J’ajoute seulement ici l’observation que dès qu’une nation poursuit cette route, le système se complette, puisque l’idée d’une de ces catégories conduit naturellement à l’autre, et il faut avouer que tant qu’autant que le systême est défectueux, même l’idée d’ une seule de ces catégories manque de sa précision accomplie.
Il seroit impossible de parler sans être dirigé par un sentiment vague des formes grammaticales des mots. Mais je crois avoir montré également qu’il est possible , en ne faisant entrer qu’un nom-bre bien limité de rapports dans une phrase, de s’arrêter au point où la distinction exacte des catégories grammaticales n’est point nécessaire, qu’on peut renoncer entièrement au systême de classer chaque mot dans une de ces catégories, et de lui en attacher la marque, qu’on peut tâcher de s’éloigner, dans la formation des phrases, aussi peu que possible, de la forme des équations mathématiques. Il suit également de ce qui a été dit plus haut, qu’aucune des catégories grammaticales ne peut être conçue dans toute sa précision par celui qui n’est pas habitué à en former, & appliquer le système complet.
Les Chinois, qui sont dans ce cas, s’énoncent souvent de manière à laisser indéterminée la catégorie grammaticale à laquelle il faut assigner un mot employé ; mais ils ne sont pas forcés non plus d’ajouter à la pensée là où elle n’en a que faire, l’idée précise que telle ou telle forme grammaticale entraîne après elle. On peut en Chinois employer le verbe sans y exprimer le temps qui, dans l’énonciation des idées générales, est toujours un accessoire déplacé, on n’a pas besoin de mettre le verbe ou à l’actif ou au passif, on peut comprendre les deux modifications dans le même mot ensemble. Les langues classiques ne pouvant que rarement s’énoncer ainsi d’une manière indéfinie, doivent avoir recours à d’autres moyens pour rendre à l’idée la généralité qu’ elles ont été obligées de circonscrire en employant une forme précise.
Il mérite d’être remarqué que les deux langues Américaines des Maya[j] & des Betoi[k] ont deux manières d’exprimer le verbe dont l’une marque le temps auquel l’action est assignée, l’autre énonce purement & simplement la liaison de l’attribut avec le sujèt. Cela est d’autant plus frappant que ces deux langues attachent dans leur véritable conjugaison aussi au Présent un affixe particulier. Ces rapprochemens peuvent, ce me semble, servir à prouver que, lorsqu’on trouve de pareilles particularités dans les langues, il ne faut point les attribuer à un esprit éminemment philosophique dans leurs inventeurs. Toutes les nations dont les langues n’ont pas adopté la fixité des formes grammaticales, ajoutent, là où le sens l’exige, des adverbes de tems au verbe, et négligent de le faire dans d’autres cas, et ce n’est que cette méthode qui se régularise dans différentes langues de différentes manières. Mais il n’en reste pas moins vrai, que l’esprit philosophique s’étant développé dans la suite des tems, il peut tirer un parti fort utile de ces particularités en apparence insignifiantes.
N’adoptant point le systême des distinctions des catégories grammaticales des mots, on doit se servir d’une autre méthode pour faire connoître la liaison grammaticale des idées. C’est ce que j’ai indiqué au commencement de cette lettre et ce que je devrai développer davantage à présent. Mais j’arriverai plus facilement au but que je me propose, en appliquant dès à présent mon raisonnement directement à la langue Chinoise et en passant ainsi (NB. p. 16.) aux preuves de fait dont j’ai parlé plus haut.
J’ai pris la liberté, Monsieur, de fixer Votre attention sur la liaison étroite entre l’unité de la proposition énoncée et les formes grammaticales. Dans nos langues, nous reconnoissons cette unité au verbe fléchi, quelquefois sous entendû, mais le plus souvent exprimé grammaticalement. Autant il y a de verbes fléchis, autant il y a de propositions.
La langue Chinoise emploie tous les mots dans l’état où ils indiquent, abstraction faite de tout rapport grammatical, l’idée qu’ils expriment. Tous les mots Chinois, quoiqu’ enchaînés dans une phrase, sont in statu absoluto, et ressemblent par là aux radicaux de la langue Samscrite.
La langue Chinoise ne connoit donc, à parler grammaticalement, point de verbe fléchi, elle n’a pas proprement de verbes, mais seulement des expressions d’idées verbales, & ces dernières paroissent sous la forme d’infinitifs, c’est à dire sous la plus vague de celles que nous connoissons. On peut dire à la vérité que l’expression d’une idée verbale précédée d’un substantif ou d’un pronom, équivaut en Chinois au verbe fléchi, aussi bien que les mots they like en Anglois. Il n’y a aucun doute qu’on ne puisse dans quelques unes de nos langues modernes, surtout en Anglois, former des phrases même assez longues entièrement Chinoises,[l] puisqu’aucun mot n’y porte l’exposant d’un rapport grammatical, mais la différence est néanmoins grande et sensible. Le mot like est placé, aussi grammaticalement, à l’actif & au présent, puisqu’il manque des marques du passif & des autres tems, il s’annonce donc comme verbe, celui qui le prononce, sait que dans d’autres cas ce verbe marque aussi la personne dont il est question. Un Anglois est habitué en général à combiner les élémens de la phrase d’après leurs formes grammaticales, puisqu’il existe des marques distinctives de ces formes, de veritables exposans des rapports grammaticaux dans sa langue, et c’est là le point important. Dans une langue où le manque de ces exposans forme la règle, l’esprit ne sauroit être porté à y suppléer, comme dans celles où ce manque est compté parmi les exceptions.
Ce qu’on nomme verbe en Chinois n’est pas ce qui est désigné par le terme grammatical de verbe fléchi, & c’est là en quoi diffère la matière de la forme des mots. Prononcer un verbe comme liaison de la proposition, & comme devant indiquer un rapport grammatical, c’est appliquer réellement l’attribut au sujèt, poser (par l’acte intellectuel qui constitue le langage) ce dernier comme existant ou agissant d’une manière déterminée. Or si une nation est frappée de ce rapport grammatical au point de vouloir l’exprimer, elle attachera à l’idée verbale quelquechose qui la désigne comme existence ou action réelle; elle exprimera avec l’idée matérielle, au moins une ou autre des circonstances qui accompagnent toute existence ou action, le tems, le sujet, l’objèt, l’activité ou la passivité. C’est ainsi que dans un grand nombre de langues sans flexions, par e. dans la langue Copte, la plupart des langues Américaines et dans d’autres encore, le verbe fléchi porte avec lui un pronom abrégé en guise d’affixe, soit toujours, soit au moins là où le sujèt n’est pas exprimé, c’est ainsi qu’en Mexicain le verbe est même accompagné du pronom qui représente son complément ou de ce complément lui-même qui lui est incorporé. On voit de cette manière à la forme même du verbe, s’il est neutre ou transitif. Le verbe dans toutes ces langues s’annonce comme véritable partie d’oraison, comme forme grammaticale; il désigne, outre la valeur lexicale, ce qui caractérise l’existence et l’action réelle, il prouve par là qu’il n’a pas été regardé comme l’idée vague d’une manière d’exister ou d’agir, mais comme posé réellement dans la phrase dans un étât déterminé d’existence ou d’action. En Chinois toutes ces modifications lui manquent, il n’exprime que l’idée; son sujèt, son complément, s’il en a, forment des mots séparés, le tems pour la plupart n’est pas marqué ou l’est non comme accessoire indispensable du verbe, mais comme appartenant à l’expression de l’idée de la phrase. Le soi disant, si l’on veut lui assigner une forme grammaticale, sans lui prêter ce qu’il n’annonce, ni ne possède, est à l’infinitif, c’est à dire dans un étât mitoyen entre le verbe & le substantif. Le lecteur reste entièrement douteux, si ce verbe forme, comme verbe fléchi, la liaison entre le sujet et l’attribut, ou s’il faut le regarder comme l’attribut et sousentendre le verbe substantif. Plus on se pénêtre du caractère des phrases Chinoises, plus on incline à cette dernière opinion. A peine même a-t-on besoin de sousentendre ce verbe; on peut regarder souvent la proposition, à l’instar d’une équation mathématique, simplement comme l’énonciation de la convenance ou de la disconvenance du sujèt avec l’attribut.
Une circonstance fait à la vérité aussi dans la construction Chinoise reconnoître le verbe. La langue Chinoise[m] range les mots des phrases dans un ordre déterminé, et la différence fondamentale de cet ordre est celle que les mots qui en déterminent d’autres, précèdent ces derniers, mais que ceux sur lesquels d’autres se dirigent, comme sur leur objèt, suivent ceux dont ils dépendent. Or il est dans la nature des verbes comme exprimant l’idée d’une action, d’avoir un objèt sur lequel ils se dirigent, tandisqu’il est de la nature des noms, comme désignant + des choses, (qualités ou substances) d’être déterminés dans l’étendue qu’on veut leur assigner. On reconnoit donc en Chinois les noms à la circonstance d’être précédés par leurs déterminatifs, et les verbes à celle d’être suivis par leur régime, et dans un grand nombre de phrases Chinoises on passe du mot déterminant au mot déterminé jusques au point où cet ordre devient l’inverse en conduisant du mot qui régit à celui qui est régi, ou ce qui revient au même, du mot déterminant au mot déterminé. Le mot qui occupe cette place, fait les fonctions du verbe en Chinois, et forme l’unité de la proposition. C’est ainsi que T. (Tchoûng-yoûng) p. 32. I. 1. ’wéï p. 67. XX. 2. tsáï peuvent aussi grammaticalement être regardés unissant l’attribut au sujèt.
Mais on chercheroit en vain dans cette méthode d’indiquer la liaison des mots, la véritable idée du verbe fléchi. La circonstance de faire suivre le complément à l’idée verbale, est aussi commune à l’infinitif et au participe. Le substantif même pourroit être construit ainsi, si la plupart des langues n’avoient la coutume de se servir dans ces cas de l’intermédiaire d’une préposition. De l’ autre côté le verbe Chinois est aussi bien souvent déterminé par des mots qui le précèdent. Il n’y a donc rien là qui caractérise rigoureusement sa qualité grammaticale.
L’unité même de la phrase n’est pas constituée par ce différent arrangement des mots, et l’on reste souvent douteux si l’on doit regarder une série de mots comme une ou comme deux propositions. Dans la phrase que je viens de citer, T. XX. 2. ne pourroit on pas regarder aussi poú comme terminant une proposition, et traduire regimen ordinatum est, exstat in cet.? Dans la phrase tá kŏ ̔táo rien indique-t-il qu’il faille la traduire en deux propositions valde ploravit, dixit, ou dans une valde plorando dixit? Le simple sujèt d’une proposition semble même quelquefois être énoncé isolément sans le lier immédiatement à ce qu’on nomme verbe, et placé là comme pour être pris en considération à lui seul. On le trouve souvent séparé du reste de la phrase par un signe de ponctuation, même le verbe auquel il se réfère, accompagné d’un pronom qui le représente. Tout cela me semble prouver que les Chinois ne rangent pas leurs mots d’après des formes grammaticales qui assigneroient des limites fixes aux différentes propositions, mais profèrent chaque mot comme livré préalablement isolément à la reflexion, en entrecoupant continuellement leurs phrases et ne liant les mots que là où l’idée l’exige absolument. Ils indiquent des pauses moyennant des particules finales, mais ces particules manquent souvent là où il y a des pauses très-marquées. Si je ne me trompe pas dans cette manière de regarder la construction Chinoise, le doute, si les phrases ci-dessus citées forment une ou deux propositions, ne s’élève dans l’esprit d’un Chinois.
Ne croiriez Vous pas aussi, Monsieur, que notre méthode de ranger les mots toujours rigoureusement sous les catégories grammaticales, nous force souvent à regarder comme une même proposition des phrases Chinoises qui en renferment deux ou plusieurs? Ne devroit-on pas traduire p. e. la phrase citée dans votre Grammaire n. 159. d’après le génie de la langue Chinoise: il dispose de l’empire, (utitur d’après l’analogie du n. 252)[n] il régale l’homme? La particule ì peut presque toujours se traduire ainsi, et sò ì que d’après nos idées, nous regardons comme une conjonction, forme à ce qu’il me semble une proposition incidente qui se place souvent immédiatement après le sujèt. (T. p. 64. XIX. 4.).
Les propositions qui marquent le terme d’une action dont Vous parlez, Monsieur, au nr. 84–91. de Votre Grammaire, renferment, presque sans aucune exception, originairement une idée verbale. Cela n’indiqueroit-il pas clairement la marche de la construction Chinoise? On exprime une idée verbale et la proposition d’après nos idées est terminée là, on ajoute, immé-diatement après une autre idée verbale (exprimant généralement un mouvement, une direction et passant insensiblement en préposition) et la fait suivre de son complément, c’est à dire qu’on commence une seconde proposition ayant terminé la première. Quelquefois cet ordre est retourné. Le verbe qui tient lieu de préposition, précède avec son complément et est suivi de celui dont, comme préposition, il est le régime. (Gr. 299.) Mais la construction grammaticalement, aussi dans ce cas, toujours la même.
Les idées de substantif et de verbe se mêlent et se confondent nécessairement dans les phrases Chinoises; la même particule sert à séparer, comme signe du génitif, un substantif d’un autre, et comme particule relative, le sujèt du verbe. On voit par cette circonstance seule que la langue n’adopte pas la méthode de nos formes grammaticales. Dès qu’on abandonne la rigueur des idées grammaticales, le verbe, surtout à l’infinitif peut être pris comme substantif, et il y a des langues qui pour indiquer les personnes, lui attachent les pronoms possessifs, comme aux substantifs; notre manger est à peu près la même idée que nous mangeons. En Chinois des adjectifs & même des substantifs (Gr. 55.) changent d’accent, lorsqu’ils passent en verbes, et d’après Mr. Morrison (Vol. 1. Part. 1. p. 17.), les mots usités à la fois comme noms & verbes, ont, lorsqu’ils servent de verbes, ordinairement l’accent appelé khiú. La prononciation Angloise (Walkers pronouncing dictionary. 16. éd. p. 71. §. 492.)[o] établit une distinction semblable pour les mots de deux syllabes employés à la fois comme substantifs & comme verbes. Mais en Chinois ce changement de prononciation ne décide rien sur le sens grammatical. Le mot ne devient pas proprement un verbe, mais prend seulement la signification verbale.
Je ne puis à cette occasion me dispenser de Vous addresser, Monsieur, à cette occasion |sic| une question sur les mots tchoûng yoûng. Vous les traduisez par milieu invariable, medium constans. Mais regardez Vous le rapport grammatical de ces deux mots comme étant le même que p. e. celui de tái hiŏ? J’avoue qu’il me paroît différent. Comme adjectif yoûng devroit précéder tchoûng. Il me semble qu’en appliquant nos idées, yoûng est un infinitif qui est précédé en guise d’adverbe par le mot qui le détermine, medio constare. Vous le traduisez aussi comme verbe T. p. 35. II. 2. parvi homines medio constant.
Cet exemple ne prouveroit-il pas de nouveau qu’il ne faut guères en Chinois élever la question des formes grammaticales? Ce que les mots tchoûng-yoûng expriment avec précision & clarté, c’est l’idée de persévérer (d’avoir pour coutûme) dans ce qui est appelé le milieu. Mais s’il faut attribuer à cette idée la forme du verbe fléchi, ou de l’infinitif, ou d’un substantif verbal, ou d’un autre substantif? s’il faut traduire perseverant, perseverare, perseveratio ou perseverantia? c’est là ce qui reste indécis, et après qui le genie & le caractère de la langue Chinoise n’engagent point à demander. Tout ce qu’on peut dire grammaticalement, c’est que l’idée plus étendue de yoûng est circonscrite par l’idée de tchoûng. La phrase siaò jin tchî tchoûng yoûng renferme simplement les idées vulgaire & persévérer dans le milieu, elle indique par la particule tchî que ce sont deux idées séparées l’une de l’autre pour pouvoir être comparées dans leurs différens rapports. Leur convenance, la qualité affirmative de la proposition, résulte de l’absence d’une négation. Voilà à quoi la langue se borne, elle ne détermine rien sur la forme précise de l’expression de la phrase, si l’on doit regarder yoûng, ainsi que Vous l’avez fait comme verbe fléchi, ou s’il faut suppléer après tchî le verbe substantif, ou enfin un autre verbe ainsi que Vous l’observez, Monsieur, dans Votre note sur la même phrase dans un autre passage?
Les motstá kŏ ̔táo ci-dessus cités fournissent un autre exemple bien frappant que la langue Chinoise, en indiquant la liaison des idées, ne précise pas pour cela la forme de l’expression qui pourtant rejaillit nécessairement sur l’idée même. Ces mots désignent les trois idées magnum, plorare, dicere, et annoncent que de grandes lamentations ont accompagné ou précédé le parler de quelqu’un. Mais ils laissent indécis, autant que je puisse voir,[p] si le deuxième mot doit être pris comme substantif, ou comme verbe, si les deux premiers forment une proposition à eux, ou se rattachent au troisième, si, dans ce cas, ils renferment, comme participe accompagné d’un adverbe, le sujèt du troisième, ou si en forme de gérondif ils en expriment seulement une modification de manière que le sujèt du verbe reste sousentendû? Il faut avouer que toutes ces nuances sont assez indifférentes, & qu’il suffit pour le sens du passage que l’individu dont il y est question, ait pleuré & parlé et qu’il ne soit pas marqué expressément d’intervalle entre ces deux actions. En traduisant cette phrase en latin on peut la rendre de quatre différentes manières:
Valde ploravit, dixit
plorans
plorando
cum
magno ploratu
Chacune de ces quatre phrases repré-sente l’objèt d’une manière différente, et attache une nuance particulière à l’idée, un bon écrivain ne les employeroit pas indifféremment. Il faut en traduisant en choisir une, & nuancer l’expression plus qu’elle l’est dans le texte Chinois & plus que l’idée seule ne l’exigeroit.
On pourroit faire ici l’objection que de semblables phrases ne se présentent à l’esprit d’un Chinois que sous une des formes possibles qu’elles semblent admettre, & que l’usage de la langue donne le tact de saisir cette forme précise.
Mais il est toujours de fait que les mots Chinois ne renferment aucune marque qui force ou qui autorise à les prendre plutôt sous cette forme que sous une des autres formes indiquées, et l’on peut poser en principe que dès qu’un rapport grammatical frappe vivement l’esprit d’une nation, il trouve une expression quelconque dans la langue qu’elle parle. Car ce que l’homme conçoit avec vivacité & clarté dans la pensée, il l’exprime infailliblement dans son langage. On peut également retourner ce principe, et dire: si un rapport grammatical ne trouve pas d’expression dans une langue, il ne frappe pas vivement la nation qui la parle, & n’en est pas senti avec clarté & précision. Car toute l’opération du langage consiste à donner du corps à la pensée, à en arrêter le vague par l’impression fixe et aigue des sons articulés, à forcer l’esprit de dérouler l’ensemble de la pensée dans des paroles qui se succèdent. Tout ce que dans l’esprit on veut élever à la clarté & la précision que les langues répandent sur les idées, doit par cette raison y être marqué, ou y trouver au moins en quelque façon un signe qui le représente.
Les deux moyens que la langue Chinoise emploie pour indiquer la liaison des mots, ses particules & la position des mots, ne me semblent pas non plus avoir pour but de marquer les formes grammaticales, mais de guider d’une autre manière dans l’intelligence de la tournure des phrases.
Je commence pour prouver la première partie de cette assertion, par la particule qui semble s’approcher le plus de ce que dans nos langues nous nommons suffixe ou flexion. La particule tchî paroit dans un grand nombre de phrases être un simple exposant du génitif, & équivaloir par là aux prépositions de, of, von, des langues Françoise, Angloise & Allemande. Mais lorsqu’on considère que cette même particule là où elle fait les fonctions de particule relative (en unissant p. e. le sujèt de la proposition au verbe) devient l’exposant du nominatif, et que là où elle suit le verbe (Gr. nr. 134.) comme son complément, elle se trouve à l’accusatif, on voit bien que ce n’est pas dans le sens adopté dans d’autres langues qu’on lui donne le nom d’exposant du génitif, et qu’elle ne peut point être mise dans la même ligne avec les prépositions ci-dessus citées. C’est aussi là précisément l’idée que vous en donnez, Monsieur, au nr. 82. de Votre grammaire.
Le génitif peut se passer de cette particule, même lorsque deux génitifs, dépendant l’un de l’autre, pourroient facilement prêter à l’amphibologie (Gr. 346. ex. 2.) et la particule s’emploie dans beaucoup de cas où il n’est pas question de génitif. Elle unit le sujèt de la proposition au verbe, le verbe substantif (Gr. nr. 137. ex. 2.) & d’autres verbes neutres ou passifs à l’attribut (T. p. 32. I. 4. ’weï tchî tchoûng ce qui est l’inverse de la phrase ordinaire tchî ’weï) le substantif à l’adjectif en prenant la place du verbe substantif (Gr. nr. 315. où l’adjectif, T. p. 47. XII. 2. où le substantif la précède) elle forme des adjectifs (Gr. nr. 195.) fait les fonctions d’article déterminatif ou partitif (Gr. nr. 190.) devient synonyme du pronom relatif (Gr. 192.) mais ne peut jamais être nommée purement explétive (Gr. p. 80. nt. 1.)
Je la trouve aussi entre la négation moǔ & le verbe, et desirerois bien d’apprendre, Monsieur, si la même chose peut avoir lieu avec d’autres particules négatives? ou |sic| si moǔ fait exception, puisqu’il faut la regarder (Gr. nr. 271.) comme un substantif, sujèt du verbe?
J’ai déjà observé que le nominatif, sujèt du verbe, & le génitif, quelque singulier que cela paroisse, ne diffèrent pas tellement dans leurs fonctions qu’ils ne puissent quelquefois se confondre. Cela peut arriver en Chinois, lorsque la construction & la signification du mot qui suit la particule tchî permet de le prendre comme verbe ou comme substantif. Je citerois comme exemples de tels passages ceux qui sont allégués au nr. 119. & 87. de Votre grammaire, Monsieur. On pourroit traduire le premier non cupio hominum addere (additionem) ad me, et dans le second, on pourroit regarder la phrase qui le commence, comme placée au génitif & changer vocatur en nomen. En Grec où l’infinitif se transforme sans difficulté en substantif, ces deux traductions ne rencontreroient guère d’obstacle. La même chose est encore plus évidente, lorsque tchî sert de liaison au substantif avec l’adjectif. Si ce dernier précède, il peut être pris comme placé au génitif du pluriel. (Gr. 315. studio natus debilium marcidorum sum I. est homo) si le substantif commence la phrase, l’adjectif doit être changé dans le sens substantif et thían tí tchî tá, pris en lui même, se traduit tout aussi bien coelum terraque magna (T. p. 47. XII. 2.), que coeli terraeque magnitudo. Le contexte du passage entier décide seul entre ces deux manières de rendre la phrase.
La raison de ce que j’avance ici, est claire. Les deux cas, où le génitif est placé avant le mot duquel il dépend, et où le nominatif précède le verbe, ont cela de commun que le premier des deux mots détermine l’idée du second. Leur différence ne consiste que dans la forme grammaticale qu’on donne à ce dernier. Une langue qui, ainsi que la Chinoise, n’a point égard aux formes grammaticales, mais qui borne sa grammaire à bien distinguer l’idée déterminante de l’idée déterminée, peut donc facilement traiter ces deux cas de la même manière.
La véritable fonction de la particule tchî est celle que Vous lui attribuez, Monsieur (Gr. p. 80. nt. 1.) d’éviter une amphibologie en marquant mieux le rapport qui existe entre les mots qu’elle réunit.
Si la définition de cette particule devoit encore être précisé davantage, j’y ajouterois qu’elle doit fixer l’attention de celui qui écoute, sur les mots qui la précèdent, en signe que ces mots, pris pour eux, doivent être mis en rapport avec ce qui suit. En même tems que la particule tchî réunit, elle sépare aussi, à ce qu’il me semble, et pourroit aussi être nommée séparative. Car si je ne me trompe, son effèt, lorsqu’elle marque le génitif, est aussi d’empêcher qu’on ne regarde les substantifs qui se suivent, comme placés dans le même cas en apposition,[q] et lorsqu’elle désigne le sujèt du verbe, qu’on ne prenne ce sujèt pour une expression purement modificative ou un adverbe. L’idée prend là où tchî est employé, une direction différente, mais intimement liée à celle qu’on a suivie jusque-là.
Si l’on remonte à l’origine de tchî, je vois par ce que Vous en dites, Monsieur, que ce mot signifie bourgeon, qu’il a le sens verbal de passer d’un lieu dans un autre, et qu’il est employé comme adjectif ou pronom démonstratif. (Gr. 189.)
Le premier de ses trois emplois répond entièrement à l’idée du génitif, le deuxième donne à la particule un sens plus étendu, mais il n’y a, ce me semble, que le troisième au moyen duquel on puisse expliquer toutes les différentes manières de s’en servir.
Lorsque tchî sert de complément au verbe, son sens pronominal est évident. (Gr. nr. 134.) Dans le 1. ex. du nr. 223. de Votre grammaire, Monsieur, ce complément semble se trouver devant le verbe. Mais il me semble que tchî dans ce passage doit être pris au contraire comme sujèt de la proposition. Trois déterminatifs se suivent immédiatement, et le complément du verbe doit etre sous entendu. Cela, ceci, cela même, je le disois.[r] Tchî est encore là pronom dans cette phrase où il forme à lui seul le sujèt du verbe. (Gr. nr. 191.) Dans les cas où il unit, comme génitif, le terme antécédent et le terme conséquent, où il se place entre le verbe & son sujèt, & surtout où il fait les fonctions d’article, je l’explique de la même manière. On énonce un objèt; pour y fixer davantage l’attention, on y ajoute cela! et ayant placé ce mot comme une pierre d’attente, on continue à exprimer l’idée qui doit s’y lier. La particule indique ainsi, quels sont les mots qui, ayant été séparés sous un certain rapport, doivent être liés ensemble sous un autre. Mais elle ne détermine point la manière de cette liaison, ou ne la détermine pas au moins d’après nos idées des formes grammaticales.
Si tchî n’étoit pas proprement un pronom, il seroit difficile à concevoir comment il pourroit se prendre pour tchè qui l’est évidemment. (Gr. nr. 192. 145.) En comparant ces deux déterminatifs ensemble, la nature démonstrative du premier, et la nature conjonctive ou relative du second devient évidente. Là où le but du pronom est simplement de rappeller un objèt déjà énoncé, on peut également bien employer le démonstratif (veteres, hi) & le relatif en y sousentendant le verbe substantif (veteres qui sunt scil.) mais lorsque le pronom est le complément d’un verbe, sans être suivi d’une autre idée dépendante de lui, le démonstratif seul est à sa place, et c’est là précisément que tchî est employé exclusivement. Par cette même raison tchî a un sens réstrictif (Gr. 193. 195) Tchè embrasse toute l’étendue de l’idée, tchî la détermine davantage.
Dans le style moderne la liaison grammaticale des idées paroit être la même, quoiqu’avec un mot différent. Celui qui y désigne le génitif, ti, se prend aussi pour le pronom relatif, mais il ne sert pas de complément au verbe, et porte par là moins évidemment le caractère pronominal en lui. Vous ne dites pas précisement, Monsieur, dans Votre Grammaire, si ti se place aussi, ainsi que tchî, entre le sujèt de la proposition et le verbe, Mais dans la phrase ngò eūl nỳ lây tí tchíng hào, mon enfant ton arrivée est à propos, et agréable, je le trouve employé exactement comme tchî, dans l’exemple que vous citez au nr. 315 de Votre Grammaire.
Si j’ai réussi à me rendre compte exactement des différentes acceptions de tchî, on pourroit les réduire aux trois suivantes:
1. Le sens verbal de passer. C’est peut-être à cause de cette acception que tchî signifie pour, à l’égard de (Gr. 187). Dans deux autres exemples (Gr. 123. 162.) ce sens paroit résulter du contexte, et la parti cule semble conserver son emploi grammatical ordinaire.
2. Le sens d’un pronom démon-stratif, lorsque tchî est complément ou (pour lui seul) sujèt du verbe.
3. Cette même signification pronominale, mais employée de manière que tchî devient vraiment une particule, un mot vide ou grammatical.
Si ensuite, et c’est là pourquoi j’ai crû devoir entrer dans cet examen détaillé, on se demande, à quelle classe de mots grammaticaux tchî appartient? il ne faut point, selon mon opinion, le ranger parmi ceux qui sont les exposans des catégories grammaticales des mots, mais parmi ceux qui marquent dans la construction le passage d’une idée à une autre. On pourroit peut-être distinguer ces deux classes par les noms de mots grammaticaux étymologiques et syntactiques.
La particule yè est de la même classe que tchî. Elle marque également la suspension, tient lieu du verbe substantif, ou peut être regardée, ainsi que Vous l’avez représenté, Monsieur, dans Votre dissertation sur la nature monosyllabique du Chinois (Fundgruben (NB. p. 35.) des Orients. III. 283.) comme un affixe du nominatif, et renforce le pronom relatif.
J’oserois dire, Monsieur, que dans le mémoire que je viens de citer, Vous semblez assimiler la grammaire Chinoise beaucoup plus à celle des autres langues que Vous ne le faites, à ce qu’il me semble au moins, dans vos Elémens. Dans ces derniers Vous ne suivez cette méthode qu’autant que le but d’enseigner le Chinois & de le mettre pour cet effèt en rapport avec les idées grammaticales des lecteurs le rend absolument nécessaire. Votre Grammaire est réellement, ainsi que la nature de la langue l’exige, plutôt un traité de syntaxe Chinoise soumis à la division que nous supposons dans toute grammaire d’une langue quelconque, et l’excellent résumé de la phraséologie, comparé au corps de l’ouvrage, met tout lecteur un peu exercé à juger du génie particulier des langues, parfaitement sur la voye de ne pas pouvoir se méprendre (NB. p. 35.) à celui de la langue Chinoise. Je crois plutôt avoir puisé l’idée de l’absence des formes grammaticales dans le Chinois à l’étude approfondie de vos élémens, que je ne craigne, Monsieur, de rencontrer en Vous un adversaire de cette opinion. (NB. p. 35.)
Les particules finales, <pour revenir à mon sujèt,> appartiennent entièrement à la partie de la grammaire qui détermine la forme des phrases.
Les prépositions ne peuvent pas, comme dans d’autres langues, être prises pour des exposans des cas des mots, puisque les mots qui dépendent d’elles ne souffrent aucune altération, qu’ elles gardent elles mêmes la construction, que leur assigne leur signification primitive et que le seul changement qu’elles éprouvent en passant à l’étât de prépositions, est la généralisation de l’idée primitive.
On peut dire la même chose des marques des temps des verbes. Elles désignent beaucoup plus, à l’instar de tout autre mot plein, des idées, qu’elles n’indiquent grammaticalement le rapport du temps . Elles sont tellement loin de faire partie du verbe, que Vous observez, Monsieur, que même dans le style moderne, leur emploi est peu fréquent (Gr. nr. 357.) On n’y découvre pas même une tendance à s’amalgamer avec le verbe. Car il y en a qui peuvent à volonté le précéder et le suivre, et d’autres qui peuvent en être séparées par d’autres mots. Elles accompagnent le verbe également & sans altérer le moins du monde leur forme, là où il est verbe fléchi, et là où il se trouve à l’infinitif. Le passage cité nr. 370. de Votre Grammaire en fournit un exemple frappant, qui prouve aussi en général que les phrases Chinoises ont un sens clairement et précisément exprimé, dès qu’on se borne à examiner de quelle manière une idée est déterminée par l’autre, mais qu’on est livré à l’incertitude sur la forme de l’expression, dès qu’ on veut ranger les mots selon les idées des catégories grammaticales. La seconde proposition de ce passage est déterminée par le mot chî qui termine la première, et celui-ci l’est à son tour par ceux qui le précèdent et qui expriment une action. Rien ne sauroit être plus clair & plus précis. Mais faut-il regarder l’expression de cette action comme celle d’un fait, femme tu as préparé , y joindre, après une pause, l’idée du tems rapportée à ce fait? ou faut il prendre chî pour une conjonction et en faire régir le verbe, comme verbe fléchi, ce verbe est-il à l’infinitif et précède-t-il comme le génitif du gérondif le substantif chî, de manière que le pronom personnel devienne possessif? voilà les questions auxquelles on cherche envain la réponse dans la phrase, et qu’un Chinois, selon mon opinion, ne seroit pas même porté à élever. Ce qui est encore remarquable, c’est qu’il y est question du prétérit d’une action future, mais que le futur n’y est nullement exprimé. Si celui qui parle avoit voulû dire que, lorsque la dame dont il y est question, eut achevé de tout préparer, il lui, eût renouvellé ses remercîmens, il me semble qu’il auroit pû lui addresser les mêmes paroles.
Il me paroit résulter de ce que je viens de dire, qu’aussi sous le rapport des mots vides, la langue Chinoise diffère des autres langues. Ces dernières suppléent par ces mots au manque de flexions, dans plusieurs les mots vides tendent visiblement à faire partie des mots pleins auxquels ils appartiennent, à s’amalgamer avec eux, à devenir flexions. Il y a même bien peu de ces langues qui n’offrissent un ou autre exemple de flexions véritables ou apparentes. Les mots vides Chinois n’ont point le but d’indiquer les catégories grammaticales; mais indiquent le passage d’une partie de la pensée à l’autre, et s’adaptent, si l’on veut abso-lument les regarder du point de vue de ces catégories, à plusieurs d’entr’elles à la fois. Beaucoup de ces mots vides conservent encore si évidemment leur acception primitive, qu’on les comprend souvent mieux en les regardant comme des mots pleins, ainsi que j’ai tâché de le faire voir de ì. Vous traduisez, Monsieur, ì et yeoû (Gr. nr. 146.) par adhibere et provenire dans un passage où ces deux particules sont précédées de sò qui forme leur complément. Une construction semblable, mais plus remarquable encore, à ce qu’il me paroît, se trouve dans le Tchoûng-yoûng (p. 72. XX. 11.) ì est précédé dans ce passage de sò et suivi de sieoû chîn. Il a donc deux complémens, l’un dans son sens verbal, l’autre dans son emploi comme particule. On peut cependant le regarder aussi par rapport à ce dernier comme verbe. Car on pourroit traduire cognoscit (scil. id.) quo (per quod) tractamus τὸ instaurare l. colere corpus.
Ce que je viens de dire des mots grammaticaux de la langue Chinoise qu’ils n’indiquent pas proprement les formes grammaticales des mots, peut également à ce qu’il me semble, se dire de l’emploi que cette langue fait de la position des mots. En fixant par les lois grammaticales l’ordre des mots, on marque les parties constitutives de la pensée, mais dénuée d’autres secours, la position seule est hors d’étât de les marquer toutes. Elle laisse du vague là où des mots de différentes catégories grammaticales pourroient former une de ces parties. Aussi les langues joignent-elles pour la plûpart l’emploi de la position à celui des flexions ou de mots grammaticaux. Cela arrive même dans des idiômes qui n’ont point atteint un haut dégré de perfection, comme dans le Péruvien qui assujétit la position des mots à des lois très rigoureuses. Vous observez, Monsieur, la même chose de la langue des Tartares Mandchous qui possède aussi des formes grammaticales. Le Chinois manquant de flexions et usant très-imparfaitement de mots grammaticaux, s’en remet pour la plûpart à la position seule pour l’intelligence de ses phrases.
Sans flexions ou sans quelquechose qui en tienne lieu, on manque souvent du point fixe qu’il faut avoir pour appliquer les regles de la position. On peut dire certainement que le sujèt précède le verbe & que le complément le suit, mais la position seule ne fournit aucun moyen pour reconnoître le verbe, ce premier chainon auquel on doit rattacher les autres. Les règles grammaticales ne suffisant pas dans ce cas, il ne reste que de recourir à la signification des mots et au sens du contexte.
Sans ce moyen la position seule des mots est rarement un guide sûr pour l’intelligence des livres Chinois. Le verbe p. e. est précédé par le mot qui en forme le sujèt, mais il peut aussi l’être d’un adverbe & d’expressions modificatives. Dans le 2me exemple du nr. 177. de Votre gram-maire, Monsieur, on ignore, avant que de connoître la signi fication du mot, si kóu appartient encore au sujèt du verbe, ou s’il accompagne ce dernier comme adverbe.
Les phrases suivantes
thsin thsin (T. p. 68. XX.
5.)
khî ’weï (T. p. 75.
XX. 14.)
thîan-hià kouě kiâ (T. p. 72. XX. 11.)
tá
tchhîn (T. ib. 12.)
jeoù
youàn jín (ib.)
sont toutes ou sujèts ou complémens d’un verbe. Mais elles diffèrent toutes dans leurs rapports grammaticaux, et quoique ces rapports y fixent l’ordre des mots, ils n’y sont reconnoissables qu’à la signification et au sens du contexte. Les mots placés à la tête de ces phrases appartiennent à des catégories grammaticales différentes que les règles de la position, les traitant tous de la même manière, n’ont pas le moyen d’indiquer.
Si l’on considère attentivement la phraséologie Chinoise dont Vous avez donné, Monsieur, dans Votre grammaire[s] un résumé à la fois aussi lumineux et aussi concis, la position des mots ne marque point proprement les formes grammaticales des mots, mais se borne à indiquer quel est le mot de la phrase qui en détermine un autre. Cette détermination est considérée sous deux points de vue, sous celui de la réstriction de l’idée d’une plus grande étendue à une plus petite, & sous celui de la direction d’une idée sur une autre, comme sur son objèt. De là dérivent les deux grandes loix de la construction Chinoise auxquelles à parler rigoureusement, se réduit toute la grammaire de la langue.
Dans toutes les langues une partie de la grammaire est explicite, marquée par des signes ou par des règles grammaticales, et une autre sousentendue, supposée d’être conçue sans ce secours.[t]
Dans la langue Chinoise la grammaire explicite est dans un rapport infiniment petit comparativement à la grammaire sousentendue.
Dans toutes les langues le sens du contexte doit plus ou moins venir à l’appui de la grammaire.
Dans la langue Chinoise le sens du contexte est la base de l’intelligence, et la construction grammaticale doit souvent en être déduite. Le verbe même n’est reconnoissable qu’à son sens verbal. La méthode usitée dans les langues classiques de faire précéder le travail grammatical, l’examen de la construction, à la recherche des mots dans le dictionnaire, n’est jamais applicable à la langue Chinoise. C’est toujours par la signification des mots qu’il faut y commencer.
Mais dès que cette signification est bien établie, les phrases Chinoises ne prêtent plus à l’amphibologie. Même d’après le peu d’étude que j’ai fait jusqu’ici du Chinois, je vois avec combien de justesse Vous avez rectifié; Monsieur, dans Votre analyse beaucoup trop flatteuse d’un de mes mémoires académiques un jugement précipité que j’y avois porté sur cette langue. Mais il est sûr que, plus que dans toute (NB. p. 42.) autre , le secours le plus essentiel pour l’intelligence se trouve dans les dictionnaires, tant pour fixer l’usage des mots qui peuvent avoir une acception verbale et substantive à la fois, que surtout pour les phrases habituelles sur lesquelles je reviendrai d’abord.
La grammaire Chinoise a pû adopter cette forme, puisque la coupe des phrases Chinoises n’en exige pas une plus rigoureuse et plus variée, & la coupe des phrases est restée telle, parcequ’une grammaire aussi simple en admettroit difficilement une différente. Ces deux choses se trouvent toujours dans un rapport réciproque dans les langues.[u]
Presque toutes les phrases Chinoises sont très-courtes, et même celles qui, à en juger par les traductions, paroissent longues & compliquées, se coupent facilement en plusieurs courtes & simples, & cette manière de les envisager paroît la plus conforme au génie de la langue.
On peut rarement se borner à prendre les mots des phrases Chinoises seulement dans le sens dans lequel on les emploie isolément, il faut le plus souvent y rattacher en même tems les modifications qui naissent de la combinaison de ce sens avec l’idée qui a précédé.
C’est là surtout le cas dans l’emploi des particules. Eûl p. e. n’est presque jamais une particule purement copulative, mais pour savoir si elle veut dire et tamen (Gr. nr. 224.) ou et ideo (Gr. 178. 226. T. p. 35. II. 2. p. 60. XVIII. 2. p. 107. XXXI. 2.) il faut consulter la phrase qui la précède. Le rapport, ou opposé, ou conforme dans lequel se trouvent les deux idées que eûl lie ensemble, se rattache à la signification de la particule. C’est d’après ce même principe que dans deux propositions, dépendantes l’une de l’autre, les conjonctions qui indiquent leur dépendance,[v] sont le plus souvent supprimées (Gr. 167. T. p. 63. XVIII. 3.) La phrase Chinoise perd de son originalité, si on essaye de les rétablir. Partout où l’on comparera des traductions de passages Chinois au texte, on trouvera qu’elles ont toujours soin de lier les idées et les propositions que la langue Chinoise se contente de placer isolément. Les termes Chinois reçoivent précisément par cet isolement un plus grand poids et forcent à s’y arrêter davantage[w] pour en saisir tous les rapports. La langue Chinoise abandonne au lecteur le soin[x] de suppléer un grand nombre d’idées intermédiaires et impose par là un travail plus considérable à l’esprit. Chaque mot paroit dans une phrase Chinoise placé là pour qu’on le pèse et le considère sous tous ses différens rapports avant que de passer au suivant. Comme la liaison des idées naît de ces rapports, ce travail purement méditatif supplée à une partie de la grammaire. On peut supposer que dans le langage vulgaire l’habitude & l’emploi de phrases une fois usitées rend |sic| le même service. Vous dites dans Vos recherches sur les langues Tartares (p. 124.) Monsieur, qu’il y a en Chinois une foule prodigieuse de phrases tellement consacrées par l’usage, & si bien restreintes dans leur signification, qu’on doit les entendre et qu’on les prend en effèt toujours dans le sens qui leur a été affecté par convention, & non dans celui qu’elles auroient, si on les traduisoit littéralement. Il ne faut en général pas oublier que notre manière d’examiner & de traiter les langues, est en quelque façon l’inverse de celle dont on les forme et même dont on les parle. Quelqu’imparfait que puisse être le commencement des langues, l’homme parle dès le principe. Lorsque la langue est formée, il auroit souvent encore bien de la peine à analyser ses phrases et les prend le plus souvent dans leur ensemble, et moins, même chez nous, ceux qui parlent, ont l’esprit cultivé, plus ils possèdent de ces phrases toutes faites, moins ils osent les briser & en transposer les élémens.
Les indications de la liaison des idées sont quelquefois négligées en Chinois au point qu’un mot est avancé tout seul uniquement pour en tirer une induction dans une phrase suivante. Dans le passage du Tchoûng yoûng (p. 35. II. 2.) kiûn tseù eul chî tchoûng, sapiens, et semper medio, l’idée du sage est placée isolément, puisqu’elle renferme en elle toute la phrase suivante comme une suite nécessaire.
La langue Chinoise n’offre jamais de ces phrases longues & compliquées régies par des mots placés à une grande distance de ceux qui en dépendent, mais présente au contraire toujours un objèt isolé et indépendant, n’attache à cet objèt même aucune marque qui autorise à l’attente de ce qui va suivre, mais place après lui de la même manière isolée ou une pareille marque ou un deuxième objèt, et compose ainsi insensiblement ses phrases.
--------------------
Si j’ai réussi à me former une idée juste de la langue Chinoise, on peut, pour juger de cette langue, partir des faits suivans:
1. La langue Chinoise ne marque jamais ni la catégorie grammati-cale à laquelle les mots appartiennent, ni leur valeur grammaticale en général aux mots même. Les signes des idées dans la prononciation & dans l’écriture restent les mêmes, quelle que soit cette valeur.
Le changement d’accent des noms passés en verbes & quelques composés, nommément ceux que la terminaison tseù fait reconnoître au premier regard comme substantifs, font seuls exception à cette règle générale.
2. La langue Chinoise n’attache point les mots vides de manière aux mots pleins qu’on puisse, en enlevant de la phrase un mot plein avec son mot vide , reconnoître toujours avec précision au dernier la catégorie grammaticale du premier.
Thian tchî peut être nominatif & génitif.
3. La valeur grammaticale n’est donc reconnoissable qu’à la composition même de la phrase.
4. Elle ne l’est même alors que lorsqu’on connoit la signification d’un ou de plusieurs mots de la proposition.
5. La langue Chinoise dans sa manière d’indiquer la valeur grammaticale n’adopte point le systême des catégories grammaticales, ne les spécifie point dans leurs nuances les plus fines, et ne les détermine pas même plus que le langage le rend absolument nécessaire.
On pourroit, d’après cette dé-scription, confondre la langue Chinoise avec ces langues imparfaites de nations qui n’ont jamais atteint un grand développement dans leurs facultés intellectuelles, ou chez lesquelles ce développement n’a pas agi puissamment sur la langue; mais ce seroit, selon mon opinion, une erreur extrêmement grave.
Elle diffère de toutes ces langues par la conséquence & la régularité avec lesquelles elle fait valoir le systême qu’elle a adopté, tandis que toutes ces langues dont je viens de parler, ou s’arrêtent à moitié chemin, ou manquent le but qu’elles se proposent. Car toutes ces langues pêchent à la fois par le manque et par la redondance inutile des formes grammaticales. Par la netteté et la pureté qu’elle met dans l’application de son systême grammatical, la langue Chinoise se place absolument à l’égal des langues classiques, c’est à dire des plus parfaites parmi celles que nous connoissons, mais avec un système, non pas seulement différent, mais même opposé, autant que la nature générale des langues le permet.
Si l’on regarde les langues,[y] du point de vue duquel nous partons ici, on en trouve de trois genres différens.
La langue Chinoise renonce à la distinction précise et minutieuse des catégories grammaticales, range les mots des phrases d’après l’ordre moins restreint de la détermination des idées, et donne aux périodes une structure à laquelle ce systême est applicable.
La langue Samscrite, les langues qui ont une affinité évidente avec elle, et peut-être d’autres encore, sur lesquelles je ne voudrois rien préjuger ici, établissent la distinction des catégories grammaticales comme base unique de leur grammaire; poursuivent cette distinction jusque dans leurs dernières ramifications, et s’abandonnent dans la formation de leurs phrases à tout l’essor que ce guide sûr & fidèle leur permet de prendre. La grecque surtout jouit de cet avantage. Car je crois en effèt que même le Latin et la Samscrite lui sont inférieurs dans cette phraseologie exacte, riche & belle à la fois, qui s’insinue dans tous les replis de la pensée, & en exprime toutes les nuances.
Il reste après cela un certain nombre de langues qui visent à avoir de véritables formes grammaticales & n’y atteignent pas, qui distinguent les catégories grammaticales, mais n’en marquent qu’imparfaitement les rapports, dont par conséquent la structure grammaticale sous ce point de vue est défectueuse, ou vicieuse ou l’un & l’autre à la fois. |sic| [z] Il existe cependant entre ces langues elles-mêmes une différence très-marquée, puisqu’elles se rapprochent plus ou moins de celles à formes grammaticales accomplies. Ces dernières admettent également des différences de sorte qu’il seroit impossible de tirer une ligne de démarcation fixe & stable entr’elles & celles dont je parle à présent. Ce n’est souvent que le plus ou le moins qui peut (NB. p. 49.) décider du jugement qu’on doit en porter. Vos savantes recherches sur les langues Tartares, Monsieur, renferment les observations les plus judicieuses sur la comparaison des langues Manchoue, Mongole, Turque, Ouigoure avec la Chinoise & Vous énoncez l’opinion que ces langues sont inférieures au Chinois. Je partage entièrement cette opinion. J’avoue néanmoins que les points de vue desquels on peut regarder ce qu’on nomme perfection & imperfection, supériorité & infériorité d’une langue, sont si différens, que sans préciser celui qu’on saisit, ces jugemens sont bien incertains. Vous Vous placez, Monsieur, dans Vos recherches surtout dans celui de la clarté & de la précision de l’expression, mon raisonnement m’a conduit ici à examiner en combien la distinction des catégories grammaticales a été adoptée & perfectionnée.
Si l’on essaye de se reporter à l’origine de ces différences des langues, il est bien difficile de s’en faire une idée juste & précise.
Les rapports grammaticaux existent dans l’esprit des hommes quelle-que soit la mesure de leurs facultés intellectuelles, ou ce qui est plus exact, l’homme, en parlant, suit, par son instinct intellectuel les lois générales de l’expression de la pensée par la parole. Mais est-ce de là seul qu’on peut dériver l’expression de ces rapports dans la langue parlée? La supposition d’une convention expresse seroit sans doute chimérique. Mais l’origine du langage en général est si mystérieuse, il est d’une telle impossibilité d’expliquer d’une[aa] manière mécanique (NB. p. 51.) que les hommes parlent & se comprennent mutuellement, il existe dans chaque peuplade une telle correspondance naturelle, dans la méthode d’assigner des paroles aux idées que je n’oserois avancer qu’il fait impossible qu’aussi les rapports grammaticaux eussent été marqués d’emblée dans le langage primitif.
Encore cependant il est important de baser les recherches de ce genre, autant que possible sur des donnés de fait, l’examen de plusieurs langues conduit à une observation qui peut servir à expliquer l’origine des expressions des rapports grammaticaux.
On remarque qu’il est naturel à l’homme, et surtout à l’homme dont l’esprit est encore peu développé, d’ajouter, en parlant, à l’idée principale une foule d’idées accessoires exprimant des rapports de temps, de lieu, de personnes, de circonstances , sans faire attention, si ces idées sont précisément nécessaires là où on les place. Il l’est encore de ne pas être avare de paroles, mais de répéter ce qui a déjà été dit, et d’interposer des sons qui expriment moins une idée qu’ils ne marquent un mouvement de l’ame. Or c’est de ces idées accessoires, devenues compagnes habituelles des principales, et généralisées par l’instinct intellectuel & par le développement progressif de l’esprit, & des sons qui y répondent, que les exposans des rapports grammaticaux semblent être provenûs dans beaucoup de langues. |?| Dans ces langues Américaines il est visible que tandis que certains rapports (p. e. ceux du nombre & du genre) ne sont exprimés que là où le sens l’exige, un grand nombre d’autres est reproduits là, où on s’en passeroit facilement. La structure infiniment artificielle des verbes de la langue Delaware vient principalement de cette dernière circonstance. Il faut encore attribuer à cette habitude celle de plusieurs langues Américaines de ne jamais séparer les substantifs d’un pronom possessif, dût-il même être indéfini. De là et de la même habitude, plus naturelle cependant, de lier toujours des pronoms, comme sujèts & objèts, au verbe, dérive |sic| la transformation des pronoms isolés en affixes et la grande classification de ces derniers en affixes nominaux verbaux qui forme si bien la grammaire de plusieurs langues que le même mot devient substantif ou verbe selon l’affixe qui l’accompagne. Ce même passage de mots, exprimant des idées accessoires, en exposans de rapports grammaticaux se retrouve plus ou moins clairement dans les langues Basque & Copte, dans celles des îles de la mer du Sud, & des peuplades Tartares, comme Vos recherches me le semblent prouver, et indubitablement dans toutes les langues qui manquent entièrement de flexions ou dans lesquelles au moins le systême des flexions est incomplet ou vicieux.
Ce que je viens d’exposer, pourroit être l’histoire de la formation de toutes les langues, & toutes pourroient suivre la même méthode pour marquer les rapports grammaticaux. Voyons donc d’où peuvent venir les deux exceptions que nous rencontrons dans la langue Chinoise & dans les langues qui possèdent un systême complet d’exposans des rapports grammaticaux.
Ces dernières peuvent, d’après ce que je [ab] viens de dire sur l’origine du langage en général, être redevables de leur structure à leur formation primitive. Mais si l’on n’embrasse point ce systême (et je suis persuadé qu’une analyse toujours plus perfectionnée de leurs formes grammaticales, surtout du changement qu’y subissent les voyelles & l’intérieur des mots, conduira peu à peu à porter un jugement plus fondé sur ce point importans) il n’est pas impossible d’expliquer, au moins en quelques façons l’origine de leur grammaire en leur assignant la même marche qu’aux langues moins heureusement organisées. Car s’il existe un concours heureux du penchant, commun, surtout dans l’état primitif, à toutes les nations, dont j’ai fait mention, avec l’instinct qui forme les langues, si à cette disposition heureuse se joint le genre d’imagination duquel j’ai parlé plus haut, (NB. p. 53.) qui assimile les élemens du langage aux objèts du monde réel, l’opération à laquelle leur grammaire doit son origine, aura un succès complèt. La généralisation des rapports de circonstances particulières ne laissera rien à désirer, tous ceux que distingue une analyse accomplie de la parole, trouveront leurs exposans, on n’en marquera point de superflûs, & ces exposans seront tellement inhérents aux mots qu’aucun mot, enchaîné dans une phrase, ne frappera l’esprit que dans une valeur grammaticale don-née. Car on doit toujours, en comparant les langues sous le point de vue des formes grammaticales, avoir égard à la double circonstance,[ac] si une langue est parvenue à ce qu’on peut qualifier de véritable forme grammaticale, question que j’ai tâché de traiter dans un mémoire sur ces formes,[ad] et quel est le systême que ses formes présentent sous le rapport de leur nombre, de l’exactitude de leur classification & de leur régularité. Cette dernière question peut s’agiter aussi à l’égard des langues qui ne sont point parvenues à mouler de véritables formes grammaticales et c’est celle qui m’occupe surtout dans cet exposé.
Qu’une nation atteigne ce haut degré de perfection dans sa langue,[ae] dépend du don de la parole dont elle est douée. De même que les talens pour différens objèts[af] sont partagés parmi les individus, le génie des langues me paroit partagé parmi les nations. La force de l’instinct intellectuel qui pousse l’homme à parler, l’esprit et l’imagination portés vers la forme & la couleur que la parole prête à la pensée, une ouie délicate, un organe heureux et peut-être bien d’autres circonstances encore forment ces prodiges de langues qui pour une longue série de siècles deviennent les types des idées les plus fines et les plus sublimes. Ce que je veux dire ici, Monsieur, c’est qu’en combinant le génie, inné à l’homme pour les langues, avec les circonstances qui entourent naturellement l’étât primitif de la société, on peut, je ne dis pas expliquer en détail, mais prouver la possibilité de l’origine des langues les plus parfaites,[ag] et voilà la ligne sur laquelle je voudrais me tenir. Je ne crois pas qu’il faille supposer aux nations auxquelles on est redevable de ces langues, des facultés plus qu’ humaines ou vouloir les exorter de la marche progressive à laquelle les nations sont assujéties; mais je suis pénétré de la conviction qu’il ne faut pas méconnoître cette force vraîment divine que recèlent les facultés humaines, le génie créateur des nations surtout dans l’étât primitif où toutes les idées & les facultés mêmes (NB. p. 55.) de l’ame empruntent une force plus vive de la nouveauté des impressions, & où l’homme peut pressentir des combinaisons auxquelles il ne seroit jamais arrivé par la marche lente & progressive de l’expérience. Ce génie créateur peut franchir les limites qui semblent prescrites au reste des mortels, ce génie dont & s’ il |sic| est impossible de retracer sa marche, sa présence vivifiante est évidente & manifeste. Plutôt que de renoncer dans l’explication de l’origine des langues à l’influence de cette cause puissante & première et de leur assigner à toutes une marche uniforme & mécanique qui se traineroit pas à pas du commencement le plus grossier jusqu’ à leur perfectionnement , j’embrasserois l’opinion de ceux qui rapportent l’origine des langues à une révélation immédiate de la divinité. Ils reconnoissent au moins l’étincelle divine qui reluit à travers tous les idiômes, même les plus imparfaits et les moins cultivés.
En posant ainsi comme premier principe dans toute recherche sur les langues, qu’il faut renoncer à vouloir tout expliquer et se borner souvent à n’indiquer que les faits, je ne partage nullement l’opinion que toutes les flexions ayent été dans leur origine des affixes détachés. Je conviens qu’il est, ainsi que Vous l’avez énoncé, Monsieur, assez naturel de supposer cette transformation, je crois même qu’elle a eû lieu dans un très grand nombre de cas, mais il est bien certainement aussi arrivé que l’homme a senti qu’un rapport grammatical s’exprimeroit d’une manière plus décisive par un changement du mot et il seroit plus que hasardé de poser ainsi des bornes au génie créateur des langues. Ce qui fait qu’on mécon-noit quelquefois la vérité dans ces matières, c’est qu’on apprécie rarement assez la force qu’exerce le plus simple son articulé sur l’esprit par la seule circonstance qu’il s’annonce comme le signe d’une idée. Comment sans cela se feroit-il que les différences les plus fines de voyelles se conservassent, sans altération, par des siècles entiers? J’ai dirigé dans un passage de nos recherches[ah] l’attention sur cette ténacité avec laquelle les nations s’attachent aux plus légères nuances de prononciation. Comment sans cela des différences très essentielles d’idées se lieroient-elles au seul changement d’une voyelle , ainsi que Vous en citez, Monsieur, un exemple infiniment remarquable dans la langue Mandchoue? (p. 111. 112.)
Avant que de tenter une explication de la langue Chinoise je dois encore développer davantage l’idée que je me forme de sa véritable nature. J’ai parlé presqu’exclusivement jusqu’ici des qualités qu’elle ne possède pas, mais cette langue étonne par le phénomène singulier[ai] que simplement en renonçant à un avantage, commun a toutes les autres, par cette privation seule, elle en acquiert un, qui ne se trouve dans aucune. En dédaignant autant que la nature du langage le permet (car je crois pouvoir insister sur la justesse de cette expression) les couleurs & les nuances que l’expression ajoute à la pensée, elle fait ressortir les idées, et son art consiste à les ranger immédiatement l’une à côté de l’autre que leurs conformités & leurs oppositions ne sont pas senties et aperçues seulement, comme dans toutes les autres langues, mais frappent l’esprit avec une force nouvelle, & le poussent à à poursuivre & se rendre présents leurs rapports. Il nait de là un plaisir, évidemment indépendant du fond même du raisonnement, qu’on peut nommer purement intellectuel, puisqu’il ne tient qu’à la forme & à l’ordonnance des idées, et si l’on analyse les causes de ce sentiment, il provient surtout de la manière rapide et isolée dont les mots, tous expressifs d’une idée entière, sont rapprochés l’un de l’autre, & de la hardiesse avec laquelle tout ce qui ne leur sert que de liaison, en a été enlevé.
Voilà du moins ce que j’éprouve en me pénétrant d’un texte Chinois. Etant parvenû à en saisir l’originalité j’ai crû voir que dans aucune autre langue peut-être les traductions rendent si peu la force & la tournure particulière de l’original. Et n’est-ce pas toujours principalement l’homme ajouté à la pensée,[aj] c’est à dire le style dans les langues & les ouvrages, qui nous fait éprouver cette satisfaction que procure la lecture des auteurs anciens & modernes? L’idée nuë, dépourvue de tout ce qu’elle tient de l’expression, offre tout au plus une instruction aride. Les ouvrages les plus remarquables, analysés de cette manière, donneroient un résultat bien peu satisfaisant. C’est la manière de rendre et de présenter les idées, d’exciter l’esprit à la méditation, de remuer l’ame, de lui faire découvrir des routes neuves de la pensée & le sentiment qui transmet non pas seulement les doctrines, mais la force intellectuelle même qui les a produites, d’age en age à une postérité reculée. Ce que dans l’art d’écrire, intimément lié à la nature de la langue dans laquelle il s’exerce, l’expression prète à l’idée, ne peut point en être détaché sans l’altérer sensiblement, elle n’est la même que dans la forme dans laquelle elle a été conçue par son auteur. C’est par là que l’étude de différentes langues devient précieus & c’est en se plaçant dans ce point de vue que les langues cessent d’être regardées comme une variété embarrassante de sons et de formes.
Je ne me dissimule guères ce qu’on a coutûme d’attribuer au plaisir de la difficulté vaincue. Mais la difficulté qu’offre |sic| les textes Chinois dont je parle ici, entourés de nombreux secours, n’est pas bien grande, ceux qui ne se refusent point à des études dans lesquelles la difficulté vaincue n’offre que des épines, ne peuvent guere se se |sic| méprendre ainsi.
Comme la langue Chinoise renonce à tant de moyens par lesquels les autres langues varient & enrichissent l’expression, on devroit croire que ce qu’on nomme style dans ces dernières, lui manquât entièrement. Mais le style très marqué qui dans les ouvrages Chinois doit être attribué à la langue elle-même, vient, à ce qu’il me semble du contact immédiat des idées, du rapport tout a fait nouveau qui naît entre l’idée et l’expression par l’absence presque totale de signes grammaticaux, & de l’art, facilité par la phraséologie Chinoise, de ranger les mots de manière à faire ressortir de la construction même les relations réciproques des idées. C’est dans ce dernier point que la force & la justesse de l’impression sur le lecteur dépend du talent & du gout de l’auteur qui peut aussi, comme les styles antique & moderne le prouvent, renforcer celle produite par l’abscence des signes grammaticaux, en usant plus ou moins sobrement de ces signes.
Je distingue la langue Chinoise des langues vulgairement appellées imparfaites par la conséquence & la régularité, des langues classiques par la nature opposée de son systême grammatical. Les langues classiques assimilent leurs mots aux objèts réels, les douent des qualités de ces derniers font entrer dans l’expression des idées toutes les relations qui naissent de ces rapports des mots dans la phrase, et ajoutent à l’idée par ce moyen des modifications qui ne sont pas toujours absolument requises par le fond essentiel de la pensée qui doit être énoncée. La langue Chinoise n’entre pas dans cette méthode de faire des mots des êtres dont la nature particulière réagit sur les idées, elle s’en tient purement & nettement au fond esssentiel de la pensée et prend pour la revêtir de paroles aussi peu que possible de la nature particulière du langage.
Il faudra donc, pour approfondir pleinement la matière que nous traitons ici, déterminer ce qui répond proprement dans l’âme à l’opération par laquelle les langues, en liant les mots d’après les rapports qu’elles leur ont assignés, ajoutent à la pensée des nuances qui naissent uniquement de leur forme grammaticale?
Je répondrois à cette question que la faculté de l’ame à qui cette opération appartient, est précisément celle qui inspire ce travail (NB. p. 61.) aux langues, c’est à dire l’imagination, mais non pas l’imagination en général, mais l’espèce particulière de cette faculté qui revêt les idées de sons pour les placer au dehors de l’homme, pour les faire revenir à son oreille proférées, comme paroles, par la bouche d’êtres organisés ainsi que lui, et les faire ensuite de nouveau agir en lui comme idées fixées par le langage. Les langues à formes grammaticales accomplies, ainsi qu’elles doivent leur origine à l’action vive & puissante de cette faculté, réagissent fortement sur elle, la langue Chinoise se trouve pour l’un & l’autre de ces procédés, dans le cas contraire.
Mais l’influence que les langues exercent sur l’esprit par une structure grammaticale riche & variée s’étend bien au delà de ce que je viens d’exposer. Ces formes grammaticales, si insignifiantes en apparence, en fournissant le moyen d’étendre & d’entrelacer les phrases selon le besoin de la pensée, livrent cette dernière à un plus grand essor , lui permettent & l’engagent (NB. p. 62) à exprimer jusqu’aux moindres nuances, & jusqu’aux liaisons les plus subtiles. Les idées formant (NB. p. 62) dans la tête de chaque individu un tissu non interrompû, elles trouvent dans l’heureuse organisation de ces langues le même ensemble, la même continuité, l’expression de ces passages presqu’ insensibles qu’elles rencontrent en elles mêmes. La perfection grammaticale qu’offrent les langues classiques, est à la fois un moyen de donner à la pensée plus d’étendue, plus de finesse & plus de couleur, et une manière de la rendre avec plus d’exactitude & de fidélité, par des traits plus prononcés & plus délicatement expressifs et en y ajoutant une symmétrie |sic| des forme & une harmonie de sons analogues aux idées énoncées & aux mouvemens des l’ame qui les accompagnent. Sous tous ces rapports une grammaire imparfaite et qui ne met pas pleinement à profit toutes les ressources des langues, seconde bien |sic|[ak] ou entrave l’activité & l’essor libre de la pensée.
D’un autre côté l’homme peut, en combinant & en énonçant ses idées, se livrer avec plus d’abandon ou avec plus de réserve à l’imagination qui forme les langues. Quoiqu’il ne puisse penser sans le secours de la parole, il discerne cependant très-bien le penser détaché des liens & libre des prestiges du langage de celui qui y est assujétie. Il n’a du premier qu’une sensation vague, mais qui en prouve néanmoins l’existence. Comment d’ailleurs se plaindroit il si souvent de l’insuffisance du langage, si les idées & les sentimens ne dépassoient pas, pour ainsi dire, la parole? Comment d’ailleurs nous verrions nous, même en écrivant dans notre langue maternelle, parfois en embarras de trouver des expressions qui n’altèrassent en rien le sens que nous voulons leur donner? Il n’y a aucun doute, la pensée, libre des liens de la parole, nous paroit plus entière & plus pure. Aussi dès qu’il s’agit d’idées plus profondes ou de sentimens plus intimes, donnons nous toujours aux paroles, une signification qui déborde, pour ainsi dire, leur acception commune, un sens ou plus étendû, ou autrement tourné, & le talent de parler et d’écrire consiste alors à faire sentir ce qui ne se trouve pas immédiatement dans les mots. C’est un point essentiel dans l’explication philosophique de la formation des langues et de leur action sur l’esprit des nations, que la parole dans l’intérieur de la pensée est toujours soumise à un nouveau travail, et dépouillée de ce qu’isolée de l’homme, elle a de roide & de circonscrit.
Je ne me suis point arrêté ici sur cette divergence de la pensée & de la parole pour en faire une application immédiate au Chinois, & pour attribuer chimériquement la structure particulière de cette langue à une tendance de cette nation à s’affranchir des liens et des prestiges du langage. Mon but a été uniquement de montrer que l’homme ne cesse jamais de faire distinction entre la pensée et la parole, et que, si la double activité qui le porte vers l’une et vers l’autre, n’est point égale, l’une se ranime à mesure que l’autre se rallentit.
Ce qui manque à la langue Chinoise se trouve tout entier du côté de l’imagination formative des langues, mais réagit ensuite sur l’action de la pensée elle-même; en revanche la langue Chinoise gagne par sa manière simple, hardie & concise de présenter les idées. L’effèt qu’elle produit, ne vient pas des idées seules, ainsi présentées, mais surtout de la manière dont elle agit sur l’esprit par son système grammatical. En lui imposant un travail méditatif beaucoup plus grand qu’aucune autre langue n’en exige de lui, en l’isolant sur les rapports des idées, en le privant presque de tout secours à peu près machinal, en fondant sa construction presqu’exclusivement sur la suite des idées rangées selon leur qualité determinative, elle réveille & entretient en lui l’activité qui se porte vers la pensée isolée & l’éloigne de tout ce qui pourroit en varier et embellir l’expression. Cet avantage ne s’étend cependant pas uniquement sur le maniement d’idées philosophiques, le style hardi & laconique du Chinois anime aussi singulièrement les récits & les déscriptions et donne de la force à l’expression du sentiment. Quel beau morceau p. e. que celui de la tour de l’intelligence![al]
Je conviens que ces passages nous étonnent & nous frappent davantage par le contraste qu’ils forment avec nos langues et nos constructions, mais il n’en reste pas moins vrai qu’en se livrant à l’impression qu’ils produisent, on peut se faire une idée de la direction que cette langue étonnante donne à l’esprit, et de laquelle elle a dû nécessairement tirer elle-même son origine.
C’est donc par le contraste qu’il y a entre elles et les langues classiques que la langue Chinoise acquiert un avantage étranger à ces langues à formes grammaticales acomplies. Elles peuvent à la vérité, et l’Allemand me semble surtout avoir cette facilité, y atteindre dans quelques locutions et jusqu’à un certain degré, mais les idées ne se présentent jamais dans un tel isolement, leurs rapports logiques ne s’aperçoivent pas d’une manière aussi tranchée, aussi pure et aussi nette à travers une construction dont le principe est de tout lier, et dans une phraséologie où les mots, purement comme tels, jouent un rôle considérable.
Mais malgré cet avantage la langue Chinoise me semble, sans aucun doute, très-inférieure, comme organe de la pensée, aux langues qui sont parvenues à donner un certain degré de perfection au systême qui est opposé au sien.
Cela suit déjà de ce qui vient d’être indiqué. Si l’on ne sauroit nier que ce n’est que de la parole que la pensée tient sa précision & sa clarté, il faut aussi convenir que cet effèt n’est complet qu’autant que tout ce qui modifie l’idée, trouve une expression analogue dans la langue parlée. C’est là une vérité évidente, et un principe fondamental.
On dira que la langue Chinoise ne s’ oppose pas à ce principe, que tout y est exprimé, même tout ce qui regarde les rapports grammaticaux, & je suis loin de le nier. La langue Chinoise a certainement une grammaire fixe et régulière, et les regles de cette grammaire déterminent, à ne pas pouvoir s’y méprendre, la liaison des mots dans l’enchainement des phrases.
Mais la différence est qu’à bien peu d’exceptions près, elle n’attache pas aux modifications grammaticales des sons, en guise de signes, mais abandonne au lecteur le soin de les déduire de la position des mots, de leur signification & même du sens du contexte, et qu’elle ne façonne pas les mots pour l’emploi dans la phrase. Cela est important en lui-même, mais (NB. p. 66.) plus encore par la raison que cela rétrécit la phraséologie Chinoise, force a entrecouper les périodes, et empêche l’essor libre de la pensée dans ces longs enchaînemens de propositions à travers lesquelles les formes grammaticales seules peuvent servir de guides.
Plus l’idée est rendue individuelle, & plus elle présente de côtés |sic| à toutes les facultés de l’homme, plus elle remue, agite & inspire l’ame; de même plus il existe de vie & d’agitation dans l’ame, & plus le concours de toutes ses facultés se réunit dans son activité, plus elle tend à rendre l’idée individuelle. Or l’avantage à cet égard est entièrement du côté des langues qui regardent l’expression comme un tableau de la pensée dans lequel tout est continû et fermement lié ensemble, et où cette continuité est imprimée aux mots mêmes; qui répandent de la vie sur ces derniers en les diversifiant dans leurs formes selon leurs fonctions; et qui permettent à celui qui écoute, de suivre, toujours à l’aide des sons prononcés, l’enchaînement des pensées, sans l’obliger à interrompre ce travail en remplissant les lacunes que laissent les paroles. Il se répand par là plus de vie & d’activité dans l’ame, toutes ces facultés agissent avec plus de concert, et si le style Chinois nous en impose par des effets qui frappent, les langues d’un systême grammatical opposé nous étonnent par une perfection que nous reconnoissons comme celle à laquelle le langage doit réellement viser.[am]
J’ai observé plus haut que la forme particulière dans laquelle la langue Chinoise circonscrit ses phrases, est la seule compatible avec une absence presque totale de formes grammaticales. C’est sur cette liaison étroite entre la phraséologie et le systême grammatical qu’il est indispensable, selon moi, de fixer l’attention pour ne pas donner contre un des deux écueils, ou de prêter, par manière d’interprétation, à la langue Chinoise des formes grammaticales qu’ elle n’ a point, ou de supposer ce qui est impossible par la nature même du langage.
Ce n’est qu’ en se bornant à des phrases toutes simples & courtes, en s’arrêtant à tout moment, comme pour prendre haleine, en n’avançant jamais un mot duquel d’autres très-éloignés doivent dépendre qu’on peut à ce point se passer de formes grammaticales dans une langue. Dès qu’on tenteroit d’étendre & de compliquer les phrases, on seroit forcé à détermi-ner par des signes quelconques les différentes fonctions des mots, et ne pourroit plus abandonner l’emploi de ces signes, ainsi que le fait le Chinois, au tact et au goût des auteurs. J’ai taché de prouver plus haut que les formes grammaticales tiennent surtout à la coupe et à l’unité des propositions. Or il existe un point où la simple distinction du sujèt, de l’attribut & de leur liaison ne suffit plus pour se rendre compte de l’enchainement des mots, où il faut spécifier ces idées, encore purement logiques, par des idées proprement grammaticales, c’est à dire puisées dans la nature de la langue, et c’est, si j’ose le dire, sur cette ligne étroite, où se tient la langue Chinoise.[an] Elle la dépasse à la vérité et l’art de sa grammaire consiste à lui en fournir les moyens sans sortir de son systême, mais l’étendue et la tournure qu’elle donne aux périodes est toujours compassée dans la mesure de ses moyens. Il est clair d’après cela qu’elle s’arrête à un point, où il est donné aux langues de continuer leur marche progressive,[ao] & c’est déjà par là qu’elle reste, selon ma conviction la plus intime, au-dessous des langues à formes grammaticales accomplies.[ap]
Il faut encore ajouter à tout cela que la langue Chinoise est dans une impossibilité absolue d’atteindre aux avantages particuliers de ces dernières,[aq] tandis que les langues qui dirigent la construction par des formes grammaticales, peuvent, si le sujèt l’exige, en user plus sobrement, supprimer souvent les liaisons des idées, employer les formes les plus vagues, et non pas égaler, mais au moins suivre à une certaine distance le laconisme & la hardiesse de la diction Chinoise. Il dépend toujours d’un emploi sage & judicieux des moyens d’expression dans ces langues que la diction[ar] n’affoiblisse point la force , ni n’altère la pureté des idées. Dans ce point, il est vrai, l’avantage reste entièrement du côté du Chinois. Dans les autres langues c’est la simplicité & la hardiesse de telle expression, de tel tour de phrase, dans les ouvrages Chinois c’est la simplicité & la hardiesse de la langue elle-même qui opère ainsi sur l’esprit. Mais cet avantage est acheté aux dépens d’autres plus importans & plus essentiels.[as]
L’absence des formes grammaticales rappelle le parler des enfans qui placent ordinairement les paroles sans les lier suffisamment entr’ elles. On suppose une enfance aux nations, comme aux individus, et rien donc n’est plus naturel que de dire que la langue Chinoise s’est arrêtée à cette époque du développement genéral des langues.
Il y a certainement un fond de vérité dans cette assertion, mais à certain égard je la crois fausse, & et ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle est bien loin d’expliquer le phénomène singulier de la langue Chinoise.
Je dois observer en premier lieu que l’enfance des nations, quelqu’usage qu’on fasse de cette expression, est, à mon avis, toujours un terme impropre. L’idée de l’enfance renferme celle de la relation à un point fixe, donné par l’organisation même de l’être à qui on l’attribue, au point de sa maturité. Or il existe bien peut-être, & pour mon particulier j’en suis entièrement persuadé, dans les développemens progressifs des nations, un point qu’elles ne dépassent pas & à compter duquel leur marche devient plutôt rétrograde, mais ce point ne peut pas être nommé un point de maturité. Une nation ne peut pas être regardée comme adulte & par la même raison pas comme enfant. C’est que la maturité suppose nécessairement un individu, et ne peut s’appliquer à un être collectif quelque grande que soit l’influence réciproque que les individus, appartenant à cet être collectif, exercent l’un sur l’autre. La maturité tient aussi toujours au physique, et une nation, quoique des causes physiques influent sur l’affinité de ceux qui la composent, ne forme un ensemble que dans un sens moral & intellectuel. Le développement de la faculté de parler est entièrement lié au physique de l’homme, et tous les enfans, à moins qu’une organisation anomale ne s’y oppose, apprennent a parler à peu près au même age, & au même degré de perfection. Cette même faculté s’augmente et s’étend sans doute dans l’homme adulte avec le cercle des ses idées & suivant les circonstances, mais cet accroissement, dépendant sous beaucoup de rapports du hasard, est entièrement différent du premier développement de la parole, qui arrive nécessairement & par la nature même des forces intellectuelles. Les nations peuvent se trouver à différentes époques des progrès de leurs langues par rapport à cet accroissement, mais jamais par rapport à ce développement premier. Une nation ne peut jamais, pas même pendant l’age d’une seule génération, conserver ce qu’on nomme le parler enfantin. Or ce qu’on veut appliquer à la langue Chinoise tient précisément à ce parler, & au premier développement du langage.
Je crois donc pouvoir inférer de ces raisons que les inductions tirées de la manière de parler des enfans ne décident rien dans un raisonnement quelconque sur la nature & le caractere particulier des langues.
On pourroit plutôt parler d’une enfance dans les langues mêmes, quoiqu’aussi l’emploi[at] de ce terme exigeât aussi beaucoup de circonspection. On trouve, à ce qu’il m’a semblé du moins dans mes recherches, en suivant les changemens d’une langue pendant des siècles, que, quelque grands que soyent ces changemens sous beaucoup de rapports, le véritable systême grammatical & lexical de la langue,[au] sa structure en grand reste la même, et là ou ce systême aussi devient différent, comme au passage de la langue latine aux langues Romaines, on place avec raison l’origine d’une nouvelle langue. Il paroit donc y avoir dans les langues une époque à laquelle elles arrivent à une forme qu’elles ne changent plus essentiellement. Ce seroit là leur point de maturité. Mais pour parler de leur enfance il faudroit encore savoir si elles atteignent cette forme insensiblement, ou si plutôt leur premier jèt est cette forme même? et voilà sur quoi d’après l’état actuel de nos connoissances, j’hésiterois à décider.[av] Mais, supposé aussi qu’on pût attribuer aux langues un étât d’enfance, il faudroit toujours examiner par d’autres moyens, que par des inductions du parler réel des enfans parmi nous, ce qui caractérise les langues dans cet étât. primitif. |sic|
Ce qui rend tous les raisonnemens de ce genre si peu concluans et ce qui m’en détourne entièrement, c’est que ni l’histoire des nations, ni celle des langues, ne nous conduit jamais à cet étât du genre humain. Il reste hypothétique et la seule méthode saine dans toute recherche sur les langues me semble être celle qui s’éloigne, aussi peu que possible, des faits. Je vais tâcher de l’appliquer à l’examen de l’origine du Chinois, mais je vous avoue ingénuement, Monsieur, que tout ce qu’on a dit jusqu’ici à ce sujèt, et ce que j’en dirai moi-même ici, ne me satisfait nullement encore. Bien loin de m’imaginer de pouvoir retracer l’origine de cette langue extraordinaire, je devrai me borner à l’énumération de quelques unes des causes qui peuvent avoir contribué à la former ainsi.
Vous avez, Monsieur, dans Votre dissertation sur la nature monosyllabique du Chinois, établi deux faits que je regarde comme fondamentaux dans cette matière, que la langue Chinoise doit son origine à une peuplade à laquelle rien n’autorise à supposer un degré de culture plus perfectionnée |sic| que l’étât primitif de la société ne le présente naturellement, et que des langues, regardées comme très-anciennes et même des langues de peuples de moeurs grossières & incultes, loin de ressembler au Chinois dans leur Grammaire, sont au contraire hérissées de difficultés & de distinctions grammaticales.
Vous faites cette dernière observation, Monsieur, sur la langue Japonnoise.[aw] J’ai trouvé la même chose dans la langue Basque, dans les langues Américaines et dans celles de la mer Pacifique.[ax]
Il faut cependant convenir que sous quelques rapports toutes ces langues offrent aussi de grands points de ressemblance avec le Chinois. Le genre des mots ordinairement n’est pas marqué, le pluriel l’est souvent de la même manière qu’en Chinois, la coutûme singulière d’ajouter aux nombres des mots, différant suivant l’espèce des choses nombrées, y est à peu près générale, les exposans grammaticaux sont souvent supprimés de manière que les mots se trouvent placés sans liaison grammaticale, tout comme en Chinois. Il ne faut pas oublier non plus que nous ne connoissons toutes ces langues que par l’intermédiaire d’ouvrages faits par des hommes accoutumés à un systême grammatical très-rigoureux, et qu’il se peut très-bien qu’ils représentent l’emploi de ces moyens grammaticaux comme constant & indispensable, tandis que les nationaux n’en font peut-être usage, comme les Chinois, que là où l’intelligence le rend absolument nécessaire. Il faut enfin se garder contre l’apparence grammaticale qu’une langue peut recevoir quelquefois sous la main de celui qui en compose la grammaire. Car il est bien aisé de représenter comme affixe & comme flexion ce qui, considéré dans son véritable jour, se réduit en effèt à toute autre chose.
Je croirois donc trop avancer en disant positivement qu’il n’y eût même parmi les langues que je viens de nommer, aucune qui n’offrit un systême grammatical très-analogue à celui de la grammaire Chinoise. Tout ce que je puis assurer, c’est que je n’en ai pas trouvé jusqu’ici. Les analogies qui assistent réellement dans ces langues avec le Chinois[ay] et dont j’ai indiqué quelques-unes, appartiennent à à toutes les langues primitives en général, et ont laissé des traces même dans les langues à formes grammaticales accomplies. Ne forme-t-on pas dans la langue Samscrite un prétérit par le moyen du mot sma qui n’est pas même devenu un affixe, & en Grec un conjonctif par l’indicatif du verbe & la particule ἄν? Les langues que j’ai désignées sous le nom d’imparfaites, se trouvant placées entre le Chinois & les autres langues, elles doivent nécessairement conserver une certaine analogie avec ces deux classes. Mais ce qui décide la question de la différence de la langue Chinoise de ces langues, c’est que sa structure & son organisation en diffère généralement & jusque dans son principe même. J’ai parlé plus haut de l’habitude des nations d’attacher, souvent en se répétant, des idées accessoires à l’idée principale, et j’ai émis l’opinion que c’est d’elle surtout que dérivent un grand nombre de formes grammaticales. Or la langue Chinoise offre bien peu de traces de cette habitude.
J’ai lû, il y a quelques années, à l’Académie de Berlin un mémoire qui n’a pas été imprimé, dans lequel j’ai comparé la plupart des langues Américaines entre’elles, |sic| sous l’unique rapport de la manière dont elles expriment le verbe, comme liaison du sujèt avec l’attribut dans la proposition, et je les ai rangées en différentes classes sous ce point de vue.[az] Car comme cette circonstance prouve, en combien une langue possède des formes grammaticales ou en approche, elle décide de la grammaire entière d’une langue. Or parmi toutes celles que j’ai examinées dans ce travail, il n’y en a aucune semblable à la Chinoise.
Presque toutes ces langues, pour alléguer une autre circonstance également importante, ont des pronoms-affixes à coté de pronoms isolés. Cette distinction prouve que les premiers accompagnent habituellement les noms & le verbe; car si ces affixes ne sont que les pronoms abréviés, cela même montre qu’on en fait un usage extrêmement fréquent, et s’ils sont des pronoms différens, on voit par là que ceux qui parlent, regardent l’idée pronominale d’un autre point de vue lorsqu’elle est placée isolément, et lorsqu’elle est jointe au verbe ou au substantif. Le Chinois n’offre que le pronom isolé qui ne change ni de son, ni de caractère en se joignant à d’autres mots. La langue Chinoise possède à la vérité aussi des mots grammaticaux qu’elle qualifie de mots vides, mais qui n’ont pas le but de déterminer précisément la nature du mot qu’ils accompagnent, et qui peuvent si souvent être omis, qu’il est évident qu’aussi dans la pensée, ils ne se joignent pas régulièrement à ceux avant ou après lesquels on les trouve, & c’est pourtant seulement sur un emploi constant et régulier que peut se fonder la dénomination de forme grammaticale. J’avoue que par cette raison, comme par d’autres encore, je ne crois pas qu’on devroit donner aux particules Chinoises le nom d’affixes, quoique j’énonce avec grande hésitation une opinion qui est contraire à celle que Vous avez émise à ce sujèt, Monsieur, dans Votre dissertation latine.
Il y a à la vérité encore une réflexion à faire sur la comparaison du Chinois avec les langues Américaines en particulier. Bien des raisons portent à croire que les nations sauvages des deux Amériques ne sont que des races dégradées, d’après l’expression infiniment heureuse de mon frère, des débris échappés à un naufrage commun. La relation historique du voyage de mon frère, si riche en notices sur les langues Américaines et en idées profondes sur les langues en général, renferme une foule d’indices qui conduisent tous à cette supposition. Si donc ces langues sont séparées par un grand nombre de changemens de leur étât premier, s’il faut les regarder comme des idiômes corrompûs, estropiés, mélangés & altérés de toutes les manières, leur différence du Chinois ne prouveroit rien contre l’opinion que la grammaire Chinoise fût, pour ainsi dire, la grammaire primitive du genre humain. J’avoue néanmoins qu’aussi ce raisonnement ne me semble guere concluant. Celles des langues Américaines que nous connoissons le plus parfaitement, possèdent une grande régularité et bien peu d’anomalies dans leur structure, leur grammaire au moins n’offre pas de traces visibles de mélange ce qui peut très-bien s’expliquer aussi dans les vicissitudes auxquelles les peuplades peuvent avoir été exposées. Le Chinois diffère tout autant d’autres langues (NB NB. |sic| p. 78.) peu cultivées, j’en ai nommé plus haut d’autres hémisphères; toutes les nations qui parlent ces langues, auroient-elles été dans le même cas que les Américains? (NB. p. 78.) & par quel accident bizarre la nation Chinoise auroit-elle conservé à elle seule une prétendue pureté primitive? J’avoue que, bien loin de croire, que la grammaire Chinoise forme, pour ainsi dire, le regle du langage humain développé dans le sein d’une nation abandonnée à elle même, je la range au contraire parmi les exceptions. Je suis néanmoins bien loin je |sic| de nier que la circonstance (NB. p. 78.) que les Chinois, depuis que nous les connoissons, n’ont pas subi de grandes révolutions par des migrations de peuples avec lesquels ils auroient été forcés de s’amalgamer, puisse & doive avoir influé sur la structure de leur langage.
La langue Chinoise manquant de flexions, doit avoir commencé comme toutes les autres langues. qui se trouvent dans le même cas et dans lesquelles des mots, exprimant originairement des idées accessoires, sont devenûs les exposans de formes grammaticales. Cela est prouvé en quelque façon par les analogies qui se trouvent entr’elles & les langues qu’on nomme barbares. Mais pourquoi, en ayant les moyens comme les autres, n’a-t-elle pas poursuivi de même, |?| pourquoi n’a-t-elle pas changé insensiblement ses mots grammaticaux en affixes pour faire enfin de ces affixes des flexions? Si l’on considère d’un côté l’analogie du Chinois avec les langues grossières, de l’autre sa nature entièrement différente et à plusieurs égards égale à celle des langues les plus parfaites, on croit voir qu’il y ait eû une cause quelconque qui l’ait détourné de la marche routinière des langues pour s’en former une nouvelle. Mais quelle ait été cette cause, comment même un pareil changement puisse avoir lieu, voilà ce qui est difficile, si non impossible, à expliquer.
L’écriture Chinoise qui exprime par un seul signe chaque mot simple et chaque partie intégrante des mots composés, convient parfaitement au systême grammatical de la langue. Cette dernière présente, en parfaite conséquence avec son principe, un triple isolement, celui des idées, des mots, & des caractères. Je suis entièrement de Votre opinion, Monsieur, (NB. p. 80.) et je pense que les savans qui se sont laissé entraîner à presqu’oublier que le Chinois est une langue parlée, ont tellement exagéré l’influence de l’écriture Chinoise qu’ils ont, pour ainsi dire, mis l’écriture à la place de la langue. Le Chinois a certainement existé avant qu’on ne l’ait écrit, et on n’a écrit que comme on a parlé. L’écriture Chinoise n’auroit d’ailleurs présenté aucune difficulté à l’emploi de préfixes et de suffixes, elle seroit devenue, par par |sic| cet emploi, dans un plus grand nombre de cas qu’elle ne l’est àprésent, syllabique. Même des changemens dans l’intérieur d’une syllabe auroient pû s’indiquer par le moyen de signes analogues à ceux qu’on employe pour marquer les changemens de tons.
Mais il n’en est pas moins vrai pourtant que cette écriture doit aussi influée considérablement et doit influer encore sur l’esprit & par là également sur la langue des Chinois. L’imagination jouant un si grand rôle dans tout ce qui tient au langage, le genre d’écriture qu’adopte une nation, n’est jamais indifférent. Les caractères forment une image de plus de laquelle se revêtent les idées, & cette image s’amalgame avec l’idée même, dans ceux qui font un usage fréquent de ces caractères. Dans l’écriture alphabétique cette influence est plutôt négative. L’image de signes qui ne disent rien par eux-mêmes, ou ne se présente guère, ou ramène au son qui est la véritable langue. Mais les caractères Chinois doivent puissamment contribuer, au moins souvent, à faire sentir les rapports des idées et à affoiblir l’impression des sons. La multiplicité des sons homophones invite nécessairement les personnes lettrées à se représenter toujours en même tems la langue écrite, libre des embarras qu’ils doivent causer. L’étymologie qui fait découvrir l’affinité des idées dans les langues, est naturellement double en Chinois, & repose en même tems sur les caractères et sur les mots, mais elle n’est bien évidente et manifeste que dans les premiers. Il me semble qu’on s’est encore bien peu occupé de celle des mots, mais je conçois que les recherches à faire dans ce but doivent être infiniment difficiles à cause de la[ba] simplicité des mots qui se refusent à l’analyse. Les caractères au contraire sont presque tous composés, les parties desquels ils constituent, sautent aux yeux, & leur composition a été faite suivant les idées de leurs inventeurs desquels dans un grand nombre de cas on a eû soin de conserver la mémoire. Cette composition des caractères entre même dans les beautés du style ainsi que Vous l’observez, Monsieur, dans Vos Elémens. (p. 81.) Je crois pouvoir supposer, d’après ces données, qu’aussi en parlant, & même en pensant, les caractères de l’écriture sont très-souvent présens à ceux parmi les Chinois qui savent lire et écrire, et s’il en est ainsi, on refuseroit envain à l’écriture Chinoise une très-grande influence aussi sur la langue parlée. Cette influence doit être en général celle de détourner l’attention des sons et des rapports qui existent entr’eux et les idées; et comme l’on ne met point à la place du son l’image d’un objet réel (comme dans les hiéroglyphes), mais un signe conventionnel choisi à cause de sa relation avec l’idee, l’esprit doit se tourner entièrement vers l’idée. Or c’est là précisément ce que fait la grammaire Chinoise en diminuant par l’absence d’affixes & de flexions le nombre des sons dans le discours, et en faisant trouver à l’esprit presque dans chacun une idée capable de l’occuper à elle seule. Ceux qui s’étonnent que les Chinois n’adoptent point l’écriture alphabétique, ne font attention qu’aux inconvéniens & aux embarras auxquels l’écriture Chinoise expose , mais ils semblent ignorer que l’écriture en Chine est réellement une partie de la langue, et qu’elle est intimement liée à la manière dont les Chinois, en partant de leur point de vue, doivent regarder le langage en général. Il est selon l’idée que je m’en forme, aussi bien qu’impossible que cette révolution s’opère jamais.
Si la littérature d’une nation ne devance pas l’adoption de l’écriture, elle l’accompagne ordinairement immédiatement, & il est plus probable encore que cela ait été le cas dans la Chine, puisque le genre d’écriture qu’on[bb] y a adopté, prouve par lui même un travail qu’on peut nommer en quelque façon philosophique. Cette circonstance ajoutée aux rapports que les caractères Chinois invitent à chercher entre leur composition & les idées, qu’ils expriment, & à la conformité de cette écriture avec le systême grammatical de la langue, pourroit peut-être faire comprendre, comment la langue Chinoise auroit pû, sans qu’on trouve en elle des traces d’un étât intermédiaire, passer des analogies qu’elle offre avec des langues très-imparfaites à une forme qui se prête au plus haut développement des facultés intellectuelles. Car le phénomène qu’elle présente, est en effet celui d’avoir changé une imperfection en vertu.
Mais je douterois néanmoins qu’on pût trouver la cause du systême particulier de la langue Chinoise dans cette influence de son écriture sur elle. Quoique l’art d’écrire remonte, ainsi que Vous le dites, Monsieur, dans Votre analyse de l’ouvrage de Mr. Klaproth sur l’inscription de Yü à plus de 40. siècles en Chine, il doit cependant nécessairement s’être écoulé un certain espace de tems où le Chinois étoit parlé sans être écrit. Même lorsqu’il le fut la première écriture paroit avoir été hiéroglyphique et en conséquence d’une nature différente de celle d’aujourd’hui. Il faut donc nécessairement que déjà alors le caractère de la langue aît pris une certaine forme. Si cette forme étoit analogue à celle de la plupart des langues, si la nation étoit portée à entremêler les phrases de signes destinés uniquement à marquer les rapports des idées, si sans leur écriture, elle s’auroit développé à l’instar de toutes les autres langues, je ne crois pas que ses caractères formant des groupes d’idées, l’eussent arrêté |sic| dans cette marche. C’est au contraire l’écriture qui auroit été adaptée à cette direction de l’esprit national, et nous avons vu qu’elle en possède les moyens. Mais si, comme je le crois très-positivement, la langue avoit déjà avant l’écriture, cette forme, et si la nation, déjà alors avare de sons, en faisoit le plus sobre usage possible, en plaçant les mots, signes des idées, sans liaison, l’un à côté de l’autre, le phénomène qui nous occupe, existoit déjà avant l’écriture, et demande une autre explication. Tout ce que l’écriture a pû faire, est, à mon avis, de confirmer l’esprit national dans la pente à ce genre d’expression des idées, et voilà ce qu’elle me paroit avoir fait et faire encore à un très-haut degré.
Je serois plutôt porté à chercher une des causes principales de la structure particulière de la langue Chinoise dans sa partie phonétique. Vous avez, on ne peut pas mieux, prouvé, Monsieur, que c’est entièrement à tort qu’on nomme cette langue monosyllabique. J’avoue que cette division des langues d’après le nombre des syllabes de leurs mots ne m’a jamais parû ni juste, ni conforme à une saine philosophie. Toutes les langues ont probablement été monosyllabiques dans leur principe, puisqu’il n’y a guère de motif pour désigner, autant que les mots simples suffisent au besoin, un objèt par plus d’une syllabe. Mais il paroit plus certain encore qu’aucune langue ne se trouve plus àprésent dans ce cas, et s’il y en avoit une réellement, cela ne seroit qu’accidentel, et ne prouveroit rien pour sa nature particulière. Il est néanmoins de fait que la qualité monosyllabique des mots forme la regle dans la langue Chinoise, et je ne me souviens pas d’avoir trouvé nulle part, si les Chinois en prononçant un mot polysyllabique comprennent ses différentes syllabes sous un même accent ou non. Car l’unité du mot est constituée par l’accent. Sans cette règle constante, la répartition de plusieurs syllabes dans un meme ou dans différens mots seroit arbitraire, et de compter un substantif & son affixe pour deux mots ou de le comprendre sous un seul, ne seroit plus qu’une affaire d’orthographe. Mais quoique l’accent réunisse indubitablement les syllabes pour en former le mot, l’utilité de cette règle devient à peu près nulle dans les langues dont l’accentuation est entièrement ignorée comme celle du Samscrit, ou du moins imparfaitement connue. Il est aussi quelquefois difficile aussi de juger de l’accent, puisque le même mot peut avoir un accent secondaire à côté de l’accent principal, et qu’il faut distinguer exactement ces différens accens. Il n’en est cependant pas moins indispensable de tâcher de fixer ce qui dans une langue est compris dans un même, ou séparé en différents mots, et cette recherche est au moins souvent facilitée par d’autres circonstances qu’il seroit trop long d’énumérer ici. Mais ce qui, dans le système phonétique Chinois, me paroit plus remarquable que l’abondance des monosyllabes, c’est le nombre rétréci des mots en géneral. Ce n’est pas que les autres langues eussent peut-être un plus grand nombre de syllabes vraîment primitives, mais c’est que les Chinois n’ont pas diversifié, mêlé, et composé ces syllabes suffisamment pour posséder par là une grande richesse et variété de sons.
C’est en quoi les nations me semblent différer essentiellement, et cette disposition naturelle à des sons monotones ou variés, pauvres ou riches, plus ou moins harmonieux est de la plus grande influence sur les langues. Elle tient à l’organisation physique et aux facultés sensitives, elle décide des propriétés des langues conjointement avec ce qui dans les facultés supérieures de l’ame répond à la partie du langage liée aux idées. La sobriété des Chinois dans l’usage des sons, jointe à l’aridité & à la sécheresse qu’on leur reproche, peuvent avoir produit dans leur langue, comme imperfection ce qu’un talent heureux de manier méthodiquement les idées peut avoir changé après en vertu. Mais une telle sobriété de sons une fois supposée, le systême pres-que monosyllabique une fois arrêté, l’esprit Chinois a dû être raffermi dans l’une & dans l’autre, par la nature particuliere |sic| de l’écriture qui à ce que je crois avoir prouvé, est devenue inhérente à la langue même. Comme elle offre un moyen d’en multiplier les signes sans multiplier les sons, elle doit dans l’étât actuel de la civilisation Chinoise, et depuis le tems où elle est devenue très-généralement répandue, entrer pour beaucoup dans l’expression des idées.
La richesse et la variété des sons dans les langues tient très-certainement à l’organisation physique et aux dispositions intellectuelles des nations, mais elle résulte peut-être encore davantage du contact & de l’amalgame de diverses peuplades. L’affluence de celle matière première des langues s’explique beaucoup plus naturellement par un concours de causes accidentelles, parmi lesquelles les migrations et les réunions de différentes peuplades sont les plus efficaces, que par les progrès de l’esprit inventeur des nations. L’exemple des Chinois eux-mêmes prouve que’un |sic| peuple accommode plutôt par toute sorte d’artifices ingénieux un petit nombre de mots à ses besoins qu’il ne pense à l’augmenter & à l’étendre. L’isolement des nations n’est donc jamais salutaire aux langues. Il empêche évidemment la réunion d’une grande masse de mots, de locutions & de formes qui est absolument nécessaire pour que l’heureuse disposition d’une des peuplades qui la possèdent, puisse insensiblement en former une langue vaste, riche & variée. L’ordre systématique, l’expression significative & heureuse des idées, l’aptitude des formes grammaticales aux besoins du discours, et tout ce qui est organisation et structure, vient sans doute des dispositions intellectuelles des nations, mais la matière, la masse des sons & des mots soumise à leur travail, est due au concours de ces causes qui unissent et séparent, mêlent et isolent les nations, qui certainement sont dirigées par des lois générales, mais que nous nommons fortuites, puisque nous en ignorons l’ordre & le fil. Comme aussi l’étât de nos connoissances ne nous permet jamais de remonter à l’origine première des langues, nous ne parvenons que tout au plus à l’époque où les langues se transforment & se recomposent d’idiômes & de dialectes qui ont existé longtems avant elles.
La langue Chinoise n’est pas exemte de mots étrangers, elle en renferme même, d’après Vos recherches, Monsieur, un nombre assez considérable. (Fundgruben des Orients. Th. 3. p. 285. nt. b.) Mais l’histoire de la Chine prouve que le développement social de la nation depuis que nous la connoissons, n’a guère été altéré par de grandes révolutions extérieures, par des incursions d’autres nations qui se fussent établies dans son sein, ou par un mélange quelconque, qui eût pû avoir une influence marquante sur leur langue. Il n’est gueres probable non plus qu’une pareille influence ait pû venir des nations barbares qui habitoient le païs du tems de l’arrivée des premières colonies Chinoises. Si ces colonies, ainsi qu’on l’assure, ne se composoient guere que d’environ cent familles (Tableau hist. de l’Asie par Mr. Klaproth. p. 30.) si elles se conservoient pendant une longue suite de siècles sans altération notable de leurs moeurs, de leurs usages & de leur idiôme, si enfin l’écriture date de l’origine même de la monarchie dont ces colons furent les fondateurs, ces faits historiques réunis servent sans doute à expliquer le nombre limité de signes de la langue parlée de la Chine, et même le manque de de ces sons accessoires qui forment les affixes & les flexions des autres langues.
Mais si l’on parvient ainsi à jetter quelque jour sur l’origine de ce qu’on peut nommer les imperfections de la langue Chinoise, on n’en reste pas moins embarrassé de rendre compte de l’empreinte philosophique, de l’esprit méditatif, qui se manifeste évidemment dans la structure entière de cette langue extraordinaire. On comprend en quelque façon par quelles raisons elle n’a pas atteint les avantages que nous rencontrons, plus ou moins, dans presque toutes les autres langues, mais on conçoit beaucoup moins comment elle a réussi à gagner des perfections qui n’appartiennent qu’à elle seule. Il est vrai cependant que l’antiquité de l’écriture & même de la littérature en Chine éclaircit en quelque façon cette question. Car quoique la structure grammaticale de la langue ait très-certainement devancé de beaucoup et la littérature et l’écriture, ce qui forme le fond essentiel de cette structure auroit pû appartenir à une nation grossière & peu civilisée, et la teinte philosophique que nous y voyons maintenant, a pû y être ajoutée par des têtes également profondes & élevées. Car cet avantage ne repose pas sur de nouvelles formes d’expression, dont on eût enrichi la langue, (ce qui auroit exigé le concours de la nation entière) mais beaucoup plus sur un usage à la fois judicieux et hardi des moyens qu’elle possédoit déjà, ce qui s’explique facilement, si l’on se rappelle que la plus grande partie de la grammaire Chinoise est sous-entendue.
Vous vous serez aperçu, Monsieur, que j’ai fondé tout ce que j’ai osé avancer sur la langue Chinoise, uniquement sur le style antique, sans faire mention particulière du style moderne. Il ne me paroit pas non plus que ce dernier diffère du premier de manière à pouvoir altérer un raisonnement basé sur l’analyse du langage et de la littérature vraîment classique de la Chine.
Il est vrai qu’un passage (p. 119) de Vos Recherches sur les langues Tartares, Monsieur, pourroit au premier abord en donner une idée différente. Mais en l’examinant avec plus d’attention et en étudiant Vos élémens, on conçoit qu’on comprendroit bien mal le sens de ce passage, si l’on prenoit le style moderne, pour ainsi dire, pour une autre langue, ou même pour une transformation très-essentielle de la langue primitive. En commençant à parler du style moderne dans Votre grammaire Vous posez pour base que le caractère propre de la langue Chinoise est le même dans les deux styles, et si je compare, chapitre pour chapitre,[bc] ce que Vous dites des deux styles, je trouve que l’essentiel de la structure grammaticale est, la même dans l’un & dans l’autre. Le style moderne ne désigne pas plus clairement que l’antique, la véritable forme du verbe fléchi, il n’a pas plus ni affixes, ni flexions, il fait usage de la même particule (tí) pour la construction du verbe & du substantif, il fait rarement usage des exposans des tems & modes des verbes, il supprime moins fréquemment, mais encore très-souvent les autres liaisons grammaticales, et sa plus grande différence du style antique consiste dans le grand nombre de mots composes qui pourtant ne sont pas entièrement étrangers non plus à ce dernier. Il se distingue, ainsi que Vous le dites, Monsieur, par une grande clarté & facilité, et c’est là proprement en quoi il a apporté un changement utile à l’ancienne langue, mais il atteint cet avantage en se tenant dans les mêmes limites qu’elle. Aussi dans son style moderne, la langue Chinoise ne possède pas proprement des formes grammaticales, ou du moins ne base point sa grammaire sur ces distinctions, n’attribue point aux mots des signes des catégories sous lesquelles ils tombent dans l’enchaînement du discours, mais s’éloigne dans tous ces points & sous toutes ces considérations des autres langues que nous connoissons. Voilà au moins l’idée que j’ai pû m’en former d’après les phrases citées dans Vos élémens, Monsieur, et d’après quelques pages d’un Roman, dont je tiens la copie et la traduction par les bontés de Mr. Schultz.[bd]
Je termine ici ma lettre, Monsieur, dans la juste crainte de Vous avoir fatigué par la longueur de mes réflexions. Mais le phénomène que présente la langue Chinoise, est trop remarquable, il est trop important pour l’étude de la grammaire comparative des langues de l’examiner avec soin, pour que je n’aye pas dû désirer de donner à mes idées tous les développemens dont je les ai crû susceptibles. Je le regarderai non seulement comme une marque infiniment précieuse de Votre bienveillance amicale, Monsieur, mais comme un véritable service rendû à la science, si Vous voudrez bien me dire, si l’idée que je me suis formée de la langue Chinoise, est juste, ou si une étude approfondie de cette langue fournit des données qui conduisent à d’autres résultats. J’ose appeler également Votre attention sur les idées générales dans lesquelles j’ai dû entrer. Le jugement que Vous en porterez, sera du plus grand poids pour moi, & je ne Vous dissimule point que je Vous les soumêts avec d’autant plus d’hésitation que dans la marche que je me suis proposé de tenir en appuyant mon raisonnemept toujours sur des faits, il est facile de se laisser entraîner à modeler ses idées générales d’après la langue qu’on vient d’analyser, & de s’exposer au danger de former un nouveau système[be] à l’examen d’une nouvelle langue.
Veuillez, Monsieur agréer l’assurance de ma considération la plus sentie & la plus distinguée.Fußnoten
- a |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 2.)“
- b |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 4.)“
- c |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 7.)“
- d |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 7.)“
- e |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 8.)“
- f |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 9.)“
- g |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 9.)“
- h |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 10.)“
- i |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 12.)“
- j |Editor| Zu Humboldts Maya-Grammatik siehe Christian Lehmann in: Humboldt 2009, S. 183–233. [FZ]
- k |Editor| Zu Humboldts Arbeiten zur Betoi-Sprache siehe Christiane Dümmler / Manfred Ringmacher in: Humboldt 2011, S. 389–409. [FZ]
- l |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 16.)“
- m |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 19.)“
- n |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 22.)“
- o |Editor| Diese Ausgabe befand sich in Humboldts Besitz; siehe Bücherverzeichnis in Tegel (AST, Archivmappe 75, M. 4, Bl. 7r): "Walcker’s |sic| pronouncing Dictionary. 16. Ed. London. 1816. 8." (Mueller-Vollmer 1993, S. 422 Nr. 110) [FZ]
- p |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 26.)“
- q |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 31.)“
- r |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 32.)“
- s |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 41.)“
- t |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 42.)“
- u |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 42.)“
- v |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 44.)“
- w |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 44.)“
- x |Editor| Eingefügt aus der Kustode.
- y |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 48.)“
- z |Editor| Ergänzt aus der Kustode.
- aa |Editor| Eingefügt aus der Kustode.
- ab |Editor| Diese Streichnung gehört inhaltlich nicht zu dieser Einfügung, sondern wohl eher zu dem rechts davon stehenden Haupttext. Eventuell sollte „un concours heureux“ durch „une harm[onie]“ o. ä. ersetzt werden.
- ac |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 54.)“
- ad |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 54.)“
- ae |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 54.)“
- af |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 54.)“
- ag |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 55.)“
- ah |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 57.)“
- ai |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 57.)“
- aj |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 58.)“
- ak |Editor| In der Kustode steht: moins
- al |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 65.)“
- am |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 67.)“
- an |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 68.)“
- ao |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 69.)“
- ap |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 69.)“
- aq |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 69.)“
- ar |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 69.)“
- as |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 70.)“
- at |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 72.)“
- au |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 72.)“
- av |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 72.)“
- aw |Editor| Humboldt verweist damit auf die von Abel-Rémusat 1825 herausgegebenen Eléments de la grammaire japonaise. [FZ]
- ax |Editor| Siehe dazu die Arbeiten Humboldts in der Abteilungen 2 (Baskisch), 3 (Amerika) und 6 (Kawi-Werk) der Editionsreihe "Wilhelm von Humboldt: Schriften zur Sprachwissenschaft". [FZ]
- ay |Editor| Links am Rand die Notiz: „(NB. p. 75.)“
- az |Editor| Diese zu Lebzeiten Humboldts unpublizierte Arbeit, 1994 zuerst von Jürgen Trabant nach einer Abschrift in Philadelphia veröffentlicht (Humboldt 1994a, S. 82–97), wurde zuletzt von Manfred Ringmacher textkritisch ediert in Humboldt 2016, S. 399–455; siehe dort auch die Einleitung auf S. 387–396. [FZ]
- ba |Editor| Eingefügt aus der Kustode.
- bb |Editor| Eingefügt aus der Kustode.
- bc |Editor| Notiz links am Rand: „(NB. p. 91.)“
- bd |Editor| Humboldt verweist auf Materialien, die der mit einem Brief von Friedrich Eduard Schultz vom 20. September 1825 erhalten hatte (heute in Krakau, Coll. ling. fol. 17, Bl. 93–98 [Brief]; 99–104 [6 Seiten chinesischer Text mit 5 Seiten deutscher Übersetzung]).
- be |Editor| Notiz links am Rand: „(NB. p. 93.)“